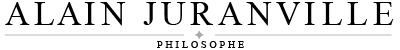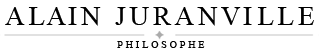Pourquoi, dans cet hommage que je veux rendre à Descartes, partir du Malin Génie ou Grand Trompeur, de cette hypothèse, de cette fiction que Descartes introduit dans la I° de ses Méditations, et dont Schelling dit qu’elle est « une raison des plus étranges »(1) ? Parce que c’est en elle que se rassemble, me semble-t-il, et je n’en étudierai que certains aspects, l’originalité la plus radicale de la pensée de Descartes, et ce qui permet de montrer le plus précisément la portée de sa position dans l’histoire. Et aussi parce qu’elle m’est apparue comme l’instrument le plus efficace pour débarrasser Descartes de l’image commune qu’on s’est faite de lui, et de ce qu’on appelle « être cartésien » (Lacan en dit ainsi : « Si vous dites Je suis cartésien, c’est dans la plupart des cas que vous n’entravez rien à ce que dit M. Descartes parce que vous ne l’avez probablement jamais ouvert »(2)). Image d’un rationalisme plus ou moins court où le sujet prend conscience de lui-même comme principe qui doit pouvoir produire ou reproduire toutes les idées claires et distinctes.
C’est l’image véhiculée par la métaphysique moderne, de Spinoza à Hegel. Image mêlée : si Descartes est reconnu comme initiateur, il est aussi considéré comme n’ayant pas su ni pu accomplir l’entreprise de raison pure dont il avait donné dans la subjectivité le principe, trop empiriquement découvert. Hegel dit de lui qu’il fut « le véritable initiateur de la philosophie moderne, en tant qu’il prit le penser pour principe », « un véritable héros qui a repris les choses entièrement au commencement, et a constitué à nouveau le sol de la philosophie, sur lequel elle est enfin retournée après que 1000 ans se sont écoulés »(3). Mais il rejette la méthode cartésienne comme « n’ayant aucun intérêt pour nous »(4), et évoque plusieurs fois sa « naïveté ». Quant à Schelling, il présente l’histoire de la philosophie moderne comme « inaugurée par Descartes .., qui agit d’une manière révolutionnaire tout à fait conforme à l’esprit de sa nation ». Mais, pour lui, « conséquence inévitable d’une rupture aussi complète, la philosophie sembla tomber dans une seconde enfance et retourner à cet état de minorité dont la philosophie grecque était sortie presque dès ses premiers pas »(5). Et lui aussi condamne la méthode, « qui ne brille pas précisément par la profondeur »(6). Cette image de Descartes, elle demeure, avec des nuances, au-delà de Hegel, dans ce que j’appellerais la pensée de l’existence. Chez Heidegger par exemple.
Or ne voilà-t-il pas que la pensée la plus contemporaine, celle qui, au-delà de la critique heideggérienne contre la subjectivité « moderne », veut concevoir une nouvelle subjectivité, se réclame de Descartes ? C’est le cas de Lacan bien sûr qui, dans le cadre de son « retour à Freud », appelle à un « retour à Descartes »(7). C’est le cas également de Lévinas, dans le combat qu’il mène, au nom de l’éthique, contre Heidegger.
Qu’en est-il donc de la position de Descartes ? La thèse que je voudrais avancer ici est que Descartes annonce ce qui ne pourra devenir réalité qu’avec l’inconscient : l’autonomie, allant jusqu’au savoir rationnel pur, d’un sujet radicalement fini. En quoi il s’oppose d’une part à la métaphysique moderne, qui réduit la finitude à l’inessentiel, et d’autre part à la pensée de l’existence, qui, de Kierkegaard à Heidegger et Wittgenstein, affirme cette finitude (et la dépendance du sujet par rapport à un Autre absolu), mais en excluant l’autonomie et le savoir rationnel. Le Malin Génie est là un enjeu de l’interprétation. On peut l’interpréter selon le rationalisme de la métaphysique moderne – finalement il y perd tout sens, ne renvoie à rien de réel. On peut l’interpréter selon la pensée de l’existence – il a bien alors un sens, mais qui brise toute possibilité de savoir absolu. Nous verrons qu’avec l’inconscient le Malin Génie trouve enfin sa réalité, dans le Surmoi, dont Lacan, à partir et au-delà de Freud, a proposé une théorie décisive. Alors il apparaîtra que le Malin Génie, bien loin d’être une pure fiction sans conséquences, est ce qu’il y a de plus terriblement réel, fond du vouloir mauvais de l’homme, le Malin, le Démon, et précisément ce que Lacan, dans un de ses mouvements sublimes, a appelé, la « haine de Dieu » – jusqu’à l’Holocauste.
Montrons d’abord comment s’est posé le problème de l’interprétation du Malin Génie.
Et commençons par ce que Descartes lui-même en dit. Il n’en parle pas dans les Règles pour la direction de l’Esprit. Il n’en parle pas non plus dans le Discours de la Méthode, où pourtant s’affirme l’entreprise du doute. Il en parle dans les Méditations, où cette entreprise est conduite à son absolu.
L’hypothèse du Malin Génie apparaît dans la I° Méditation, consacrée au doute. Il y a deux moments du doute. D’abord le doute naturel ou raisonnable, « scientifique ». Doute qui porte, par l’argument du rêve, sur la connaissance sensible, et qui dégage la vérité de la connaissance rationnelle et mathématique, celle-ci « ne [traitant] que de choses fort simples et fort générales, sans se mettre beaucoup en peine si elles sont dans la nature ou si elles n’y sont pas ». Descartes peut alors conclure au § 8 : « Soit que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de cinq, et le carré n’aura jamais plus de quatre côtés ; et il ne semble pas possible que des vérités si apparentes puissent être soupçonnées d’aucune fausseté ou d’incertitude ». Ensuite le doute hyperbolique ou métaphysique. Doute qui porte, par l’argument du Grand Trompeur, du Malin Génie, sur ce qui semblait le plus indubitable, la connaissance rationnelle elle-même. Descartes part de l’opinion qu’il a depuis longtemps d’un Dieu qui peut tout. Ce Dieu peut avoir voulu après tout « que je me trompe toutes les fois que je fais l’addition de deux et de trois, ou que je nombre les côtés d’un carré ». Cette possibilité, Descartes, pour son entreprise du doute, en fait l’hypothèse (ou la fiction) du Malin Génie : « Je supposerai donc qu’il y a, non point un vrai Dieu, qui est la souveraine source de vérité, mais un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper ». Soulignons que, pour Descartes lui-même, cette hypothèse est celle d’une discontinuité pure du temps. Si deux et trois peuvent ne pas faire cinq, c’est que je peux, quand je passe à trois, ne pas me souvenir de ce dont je suis parti. Le su-jet (celui qui se sou-vient) s’est effondré. De même la capacité de synthèse, dont Kant fera une donnée première.
L’hypothèse du Malin Génie demeure dans la II° Méditation. Là où surgit la première certitude. Quelque industrie qu’emploie à me tromper ce trompeur très rusé et très puissant, « il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant que je penserait être quelque chose ». Certitude qui tient au réel de la pensée. Quand bien même toutes mes autres pensées seraient fausses, il y en a une qui est « nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit », et c’est ego sum ego existo (Je suis, j’existe) et, à partir de là, cogito {en tant que proposition}, sum res cogitans (Je pense, je suis une chose pensante). Certitude qui est en soi celle du sujet, mais qui ne vaut que ponctuellement, tant que la continuité du temps n’est pas assurée. « Je suis, j’existe : cela est certain ; mais combien de temps ? A savoir, autant de temps que je pense ; car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d’être ou d’exister ». Où les habitués des textes de Freud entendront le Denkzwang, la contrainte à penser de Schreber face à son Dieu(8).
Celui qui, pour atteindre au savoir vrai, est entré dans le doute absolu, et a feint l’hypothèse du Malin Génie, ne peut cependant pas se contenter de cette certitude ponctuelle. D’où la III° Méditation, et la démonstration de l’existence de Dieu, du vrai Dieu qui n’est pas le Malin Génie, et qui garantit au fini ce que celui-ci ne peut pas se garantir par lui-même : la continuité du temps, sa continuité de substance pensante et de sujet, et la possibilité, non plus formelle, comme avec le morceau de cire, mais réelle, du savoir. A partir de quoi, dans les trois autres Méditations, seront recouvrés tous les savoirs mis en doute. Ce qui semblait si évident à Don Juan (« Ce que je crois ? … Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont huit »(9)) est appendu à l’existence de ce Dieu qu’il prétendait nier.
Qu’est-ce que la pensée, après Descartes, a pu faire de ce mouvement du doute absolu, et précisément de l’hypothèse du Malin Génie ? L’un des commentateurs le plus éminents de Descartes, Martial Guéroult, pose très lumineusement le problème du Malin Génie, quoique la solution qu’il y apporte ne puisse pas nous satisfaire : « L’hypothèse du Grand Trompeur, ou la fiction du Malin Génie, qui constitue l’instrument du doute métaphysique, pose un problème, celui de son origine ou de son fondement. Est-elle fondée, au moins en partie, sur la nature des choses, ayant sa racine dans certaines vérités de la philosophie cartésienne ? Est-elle, au contraire, un artifice entièrement étranger à ces vérités, et tel que celles-ci une fois découvertes abolissent radicalement le prétexte au nom duquel on prétendait l’invoquer ? »(10).
Commençons à l’inverse par cette seconde conception, qui est celle défendue par Guéroult lui-même. C’est, sous sa forme la plus précise et rigoureuse, l’interprétation rationaliste. Pour lui, l’hypothèse du Malin Génie, si elle a une fonction (élever à l’absolu le doute), est un pur artifice, qui ne dit rien de la vraie nature de rien, et en particulier de celle de Dieu et de sa toute-puissance. Cette puissance, bien conçue, fait s’évanouir toute idée de tromperie. A l’inverse, la doctrine de la création des vérités éternelles, qu’on prétend identifier à l’hypothèse du Malin Génie, témoigne bien de cette puissance. Les vérités mathématiques dépendent d’un acte de création de Dieu. Pour Guéroult, à partir de ces vérités et de leur fondation dans le vrai Dieu, puissant et bon, à partir aussi de la subjectivité découverte réflexivement, le fini peut déployer son savoir, dans l’autonomie. En rien n’est mise en question la volonté de raison.
Quant à la seconde conception présentée et discutée par Guéroult, et qu’il attribue à Henri Gouhier et à Emile Bréhier, voyons les grands traits de ce qu’il en dit. L’hypothèse du Malin Génie serait, pour cette conception, fondée sur la nature véritable de la toute-puissance divine, et devrait être rattachée, avec la doctrine des vérités éternelles, aux conséquences de cette toute-puissance prise en soi. La tromperie serait une possibilité offerte à la toute-puissance. Par bonté, Dieu limiterait sa puissance. Mais il y aurait une sorte de conflit en Dieu. « La puissance de Dieu recèlerait ainsi en son fond, conclut Guéroult à propos de cette conception, quelque chose d’irrationnel et d’anarchique »(11). Et il parle du « caractère tragique » du conflit entre la puissance et la bonté, et « d’un certain pessimisme et d’une certaine inquiétude liés au mystère de notre origine ». Je dirai que cette conception, certes discutable (les arguments de Guéroult sont efficaces), est de manière générale l’interprétation que pourrait donner la pensée de l’existence, et qu’elle se retrouve chez bien des commentateurs actuels, et des plus éminents, de ceux qui ont voulu dépasser le « rationalisme » imputé à Descartes. Jean-Luc Marion parle ainsi (c’est à propos de la théorie des vérités éternelles, mais cela montre l' »atmosphère » qu’il veut évoquer) de l' »ouverture en quelque manière tragique de 1630″(12). Que veut faire apparaître cette interprétation chez Descartes ? Que Dieu est l’Autre absolu au-delà de la raison immédiate de l’homme. Que ce dernier est marqué par une finitude radicale. Et donc qu’il atteint sa subjectivité, non pas par un mouvement de réflexion, de réminiscence, de retour vers ce qui est toujours déjà, mais par un acte, en coupant avec ce qu’il est d’abord et en se faisant sujet de ce qui pense en lui. Je voudrais, pour achever la présentation succincte de cette interprétation, donner deux textes qui en montrent toute la légitimité. L’un, de Descartes, dans la Lettre à Mersenne du 6 mai 1630 : « Pour les vérités éternelles, je dis derechef qu’elles sont seulement vraies ou possibles, parce que Dieu les connaît comme vraies ou comme possibles, et qu’elles ne sont pas au contraire connues comme vraies par Dieu comme si elles étaient vraies indépendamment de lui »(13). L’autre, de Wittgenstein, dans une conversation du 17 décembre 1930 à propos de l’Éthique de Moritz Schlick, le fondateur du positiviste Cercle de Vienne : « Schlick dit qu’il y a dans l’éthique théologique deux conceptions de l’essence du bien : dans le sens le plus superficiel, le bien est bien parce que Dieu le veut ; dans un sens plus profond, Dieu veut le bien parce qu’il est bien. Je pense que la première conception est la plus profonde : est bien ce qu’ordonne Dieu. Car cette conception du bien barre la route à toute explication qui dirait « pourquoi » le bien est bien, alors que c’est justement la deuxième qui est la conception superficielle, rationaliste »(14). Dans son ultime texte De la Certitude, Wittgenstein avance encore qu' »il y a bien aussi quelque chose comme une autre arithmétique »(15), et il souligne la portée de l’idée d’une pure discontinuité du temps. Mais ce serait folie, dit-il, et la certitude socialement reconnue se fonde sur une décision qui rompt avec cette possibilité simplement logique. Concluons sur l’interprétation par la pensée de l’existence : interprétation décisive, judicieuse, qui a libéré dans la pensée de Descartes ce qui a toujours fait le fond de sa puissance fascinatoire. Manque simplement la raison, l’engagement dans l’autonomie rationnelle. Et le travail de l’interprétation doit être repris.
Entrons maintenant dans l’interprétation qui devient possible quand on conduit à son extrême ce qui a été apporté par la pensée de l’existence, et qu’on introduit l’inconscient. Alors on peut enfin assumer les deux exigences qui ont été celles de Descartes : celle d’une part de la finitude radicale (ce sera pour la psychanalyse la castration, mais aussi, autrement, la pulsion de mort), celle d’autre part de l’autonomie rationnelle (ce que permettra l’écriture). Et la position de Descartes dans l’histoire pourra enfin être précisée.
Commençons par l’interprétation nouvelle de l’hypothèse du Malin Génie, et du mouvement subjectif dont une telle hypothèse marque l’entrée véritable.
Le sens général de cette interprétation est très exactement donné par Derrida dans son article « Cogito et Histoire de la folie », (où il discute ce que Foucault, reprenant l’interprétation rationaliste commune, avait avancé sur Descartes dans l’Histoire de la folie à l’âge classique). Pour Derrida, et pour l’interprétation nouvelle en général, l’hypothèse du Malin Génie ne dit alors plus rien de la nature véritable de Dieu (Guéroult aurait raison). Mais elle n’est pas un pur artifice. Elle dit quelque chose de la nature de l’homme. Elle est l’hypothèse même de la folie (comme nous l’avons suggéré avec Wittgenstein, et par la référence à Schreber). « Le recours à l’hypothèse du Malin Génie, dit ainsi Derrida, va rendre présente, va convoquer la possibilité d’une folie totale »(16). Disons que le Malin Génie est l’Autre tel que le conçoit le fou, et que cette folie apparaît dans le sujet pour autant que, d’une manière ou d’une autre (et cela s’accomplit dans la philosophie, mais vaut pour tout mouvement éthique, dont la cure), il vise, au-delà du monde immédiat, en rompant avec lui, un savoir total. Derrida parle, à propos de Descartes, du projet « fou » de « penser la totalité en lui échappant »(17). Cette folie où l’on se bat, pour le sens, contre le démon, contre le Malin Génie du non-sens, « à aucun moment la connaissance ne pourra à elle seule [la] dominer »(18), a fortiori la sublimer en bonne folie. Il y faudra Dieu — ce que Derrida prudemment attribue à Descartes. Mais, si Derrida a bien ainsi l’idée d’un savoir nouveau, qui s’atteindrait par rupture, selon un mouvement existentiel qui est celui décrit par Descartes, cette hyperbole qu’il louange n’est pour lui qu’une perspective critique, sans effective objectivité nouvelle.
C’est la psychanalyse, et précisément Lacan dans la lecture qu’il a faite de Freud, qui permet, toujours en reprenant le mouvement cartésien, de donner la réalité de ce savoir nouveau. C’est là que le Malin Génie reçoit son éclairage définitif, comme Surmoi. Dans ce savoir, le décisif est, pour le sujet, et à tous niveaux, une structure fondamentale quaternaire. Lacan nous l’a appris (ou réappris, puisqu’une telle structure, avec une suprême structure ternaire, est présente chez tout penseur qui a mené la pensée jusqu’à son terme). Ce savoir est d’abord en l’Autre, et le sujet a à se l’approprier, selon un mouvement lui-même quaternaire, que je représenterai ici par le schéma suivant :
Malin Génie – Surmoi (objet) Autre vrai (Autre)
sujet (sujet) Moi (Chose)
Avant de commenter ce schéma, avec Lacan, et notamment ce qu’il dit sur Descartes, il faut souligner, avec Lacan là aussi, ce qui lui donne tout son sens : la distinction fondamentale de l’Autre vrai et de l’Autre faux (ou Surmoi). L’Autre vrai appelant le sujet à s’identifier à lui dans le savoir. L’Autre faux l’en empêchant. Cette distinction, et la conception que cela implique du Surmoi, sont une nouveauté de Lacan par rapport à Freud. Du fait de son discours empiriste, celui-ci ne peut faire état (quoi que suppose son analyse) d’une altérité primordiale. Il n’y a pour lui que l’Autre que le sujet se fabrique inéluctablement, le Surmoi. Freud voit bien la haine que le sujet a pour l’Autre, qui exige de lui de renoncer à la jouissance. Il ne peut dire que cette haine est contre l’Autre vrai. Il voit bien l’amour que le sujet a aussi pour l’Autre. Il ne peut dire que cet amour, dont il sait l’ambiguïté, est, comme vrai, pour l’Autre vrai et, comme faux, narcissique, pour l’Autre faux. Lacan là apporte la clarté qu’il fallait, de sorte que nous n’avons plus « l’impression de jouer deux lignes écrites sur la même portée »(19), comme il le dit pour une distinction très voisine. Le Surmoi est pour lui haine de Dieu, haine de l’Autre vrai qui appelle à renoncer à la jouissance pour accéder au savoir. Il est fabriqué par l’homme, comme Autre faux qui évite la castration, et appelle au contraire à la jouissance. C’est cela que vise Lacan quand il avance que « la fonction du Surmoi, à son dernier terme, dans sa perspective dernière, est haine de Dieu, reproche à Dieu d’avoir si mal fait les choses »(20). Certes cette distinction, il ne la fait pas toujours, ni toujours aussi nettement. Je ne ferai référence ici qu’à deux passages. L’un, toujours extrait de L’Éthique de la Psychanalyse, où il oppose l’intériorisation de la loi (le Surmoi) et la loi(21), la loi vraie (il a parlé au début de ce séminaire du « vrai devoir », qui serait « d’aller contre [l’]impératif »(22) du Surmoi). L’autre, sur lequel je voudrais m’arrêter davantage, vient du séminaire Les Psychoses. Lacan y distingue deux Autres, avec chacun un usage différent du tu qui sert à désigner le sujet. Et il prend divers exemples venus de la grammaire de Damourette et Pichon, dont : tu es celui qui me suivras partout, et tu es celui qui me suivra partout ; tu es la femme qui ne m’abandonneras pas, et tu es la femme qui ne m’abandonnera pas. Le premier tu, qui se maintient comme deuxième personne dans la relative, est ce que Lacan appelle un tu plein(23). Le second tu, qui ne se maintient pas dans la relative et vire à la troisième personne (qui n’en est pas une, dit Lacan — ce qui serait à nuancer, notons-le), est le tu qui nous tue (« c’est celui que nous connaissons parfaitement par la phénoménologie de la psychose, et par l’expérience commune, c’est le tu qui en nous dit tu, ce tu qui se fait toujours plus ou moins discrètement entendre, ce tu qui parle tout seul, et qui nous dit tu vois ou tu es toujours le même. Comme dans l’expérience de Schreber, ce tu n’a pas besoin de dire tu pour être bien le tu qui nous parle. Il suffit d’un tout petit peu de désagrégation »(24)). Du premier tu, que Lacan rattache à la parole fondatrice (tu es ma femme,mon maître, etc.), il dit que c’est « à tout le moins une élection, peut-être unique, un mandat, une dévolution, une délégation, un investissement ». Il y a là (en particulier dans le tu es la femme qui ne m’abandonneras pas) une « plus grande confiance »(25), mais une moindre « certitude » (« Cette confiance suppose un lien plus lâche entre la personne qui apparaît dans le tu de la première partie de la phrase, et celle qui apparaît dans la relative. C’est justement parce qu’il est lâche qu’il apparaît dans une originalité spéciale à l’endroit du signifiant, et qu’il suppose que la personne sait de quelle sorte de signifiant il s’agit dans ce suivre, qu’elle l’assume. Cela veut dire aussi qu’elle peut ne pas suivre »(26)). Bref, l’Autre qui dit ce tu ouvre le sujet à sa liberté, l’appelle à se faire librement sujet de ce qui lui est signifié. Quant à l’autre Autre, celui qui dit le second tu, s’il a une plus grande certitude, c’est parce qu' »il n’y a [là] aucun tu électif »(27) (je suis à nouveau Lacan), parce que « le tu est celui qui meurt », parce qu’il a réduit le sujet à son être d’objet-déchet, sans liberté, sans autonomie. Dans cet autre Autre « nous reconnaissons, comme le dit Lacan, notre bon vieil ami le Surmoi »(28). Et il précise, comme il l’avait fait dès le I° Séminaire : « Ce Surmoi est bien quelque chose comme la loi, mais c’est une loi sans dialectique ».
Une fois dégagée cette distinction de l’Autre vrai et de l’Autre faux, le premier appelant le sujet à s’affronter à lui-même, le second étant fabriqué par le sujet pour ne plus être ainsi appelé, nous pouvons entrer dans le mouvement existentiel et structural par quoi celui-ci répond audit appel.
Les deux premiers termes, Malin Génie-Surmoi et sujet, sont ceux que le discours psychanalytique peut thématiser en propre. Je les ferai correspondre chez Lacan aux deux « opérations de la réalisation du sujet dans sa dépendance signifiante au lieu de l’Autre »(29), opérations distinguées dans le XI° Séminaire comme celles de l’aliénation et de la séparation.
D’abord le Malin Génie ou Surmoi. Il est ce nous venons de dire : l’Autre faux, produit, dans une psychose fondamentale, par le rejet, par la forclusion de l’Autre vrai et de ce à quoi il appelle — Lacan disait ainsi du Surmoi, dans « Variantes de la cure-type », qu’il est « la béance ouverte dans l’imaginaire par tout rejet (Verwerfung) des commandements de la parole »(30). C’est à cela, comme production psychotique primordiale, comme aliénation fondamentale, que s’affronte le sujet dans le mouvement par lequel il va vers lui-même, vers le réel et son réel. Ce réel, précise Lacan, est « au-delà de l’automaton, du retour, de la revenue, de l’insistance des signes »(31). Au-delà de ce démon qui pense tout seul, comme une machine à penser qui ressasse toujours les mêmes idées vaines. Le Surmoi est ce revenant, cet esprit mauvais. Il est l’inconscient aussi longtemps que le sujet n’a pas reconnu qu’il y est chez lui (« ce champ de l’inconscient le sujet y est chez lui »(32)). L’inconscient comme l’Unheimlich. L’inconscient en tant que le sujet se veut par lui « expulsé de la maison »(33). Le coup de génie de Descartes, l’un de ses coups de génie, c’est d’avoir fait de l’autre génie, du mauvais, une fiction, d’avoir bien vu que c’est le sujet qui se le fabrique. Par libido, dirait-on.
Maintenant la constitution du sujet et la séparation. Lacan dit, à propos de Descartes et de l’accession à la certitude, que « c’est, à proprement parler, l’instauration de quelque chose de séparé »(34) (et de même Lévinas : « le cogito, avons-nous dit, atteste la séparation »(35)). Pour citer toujours Lacan, « par la séparation, le sujet trouve le point faible du couple primitif de l’articulation signifiante, en tant qu’elle est d’essence aliénante »(36). Disons que le sujet dés-absoluise cette articulation, celle du retour des signes, celle du Surmoi ; qu’il y distingue ce qui relèverait d’un Autre vrai (l’absolu du sens, qui manque) et le réel du non-sens ; qu’il défait ce que Lacan appelle dans Encore la « coalescence » de l’Autre et de l’objet ; qu’il reconnaît la non-signifiance constitutive de l’objet, le fait que le sens apparaît toujours avec le non-sens ; et qu’il assume l’être à lui ainsi imparti, la finitude, sa division de sujet, ou encore la castration. Il se fait sujet de ce qui pensait et parlait en lui. Par un mouvement qui est, pour Lacan comme pour la pensée de l’existence, et à la différence du rationalisme, un acte. Acte qu’il montre décrit de manière analogue chez Descartes comme chez Freud. « La démarche de Freud est cartésienne »(37). Et encore : « C’est le sujet qui est appelé, le sujet d’origine cartésienne »(38). Et ceci : « C’est de prendre sa place au niveau de l’énonciation qui donne sa certitude au cogito »(39).
Peut-on s’arrêter là, à ces deux opérations de l’aliénation et à la séparation ? Non, parce que le sujet qui veut savoir n’a pour l’instant de certitude que ponctuelle. Il a découvert sa finitude, sa castration. Il pourrait penser qu’il a atteint son autonomie réelle dans l’énonciation, dans la parole métaphorique, et qu’il n’aurait plus qu’à la faire opérer. Dans la science en particulier. Mais il retomberait alors dans la « croyance » au Surmoi, à une toute-puissance technique ignorant la finitude et la relation à l’Autre. Don Juan, avec son deux et deux font quatre et quatre et quatre font huit, croirait au Moine bourru, comme Sganarelle. La science se confondrait avec la superstition, elle perdrait ce qui la fonde comme science. Il faut donc poser comme tels l’Autre vrai, qui n’est pas le Surmoi, et le Moi, qui répond à l’appel de cet Autre vrai. Ce que le discours psychanalytique ne peut dire sans se dédire. Et qui appartient en propre au discours philosophique. Je ne m’arrêterai qu’à ce qui s’en retrouve chez Lacan lui-même.
D’abord l’Autre vrai. Dans le XI° Séminaire Lacan reprend (à son compte, peut-on dire) Descartes. « Vous savez que Descartes n’a pu qu’en réintroduire la présence [de Dieu, du sujet supposé savoir]. Mais de quelle singulière façon ! »(40). Descartes se serait débarrassé de son sujet supposé savoir (Lacan ne peut quand même pas dire : de Dieu) « par son volontarisme, par la primauté donnée au vouloir de Dieu ». « C’est assurément, continue-t-il, un des plus extraordinaires tours d’escrime qui ait jamais été porté dans l’histoire de l’esprit — les vérités éternelles sont éternelles parce que Dieu les veut telles ». Et encore : « c’est vrai que c’est son affaire, et que deux et deux font quatre n’est pas quelque chose qui aille de soi sans sa présence »(41). Certes Descartes pour Lacan « inaugure les bases d’une science dans laquelle Dieu n’a rien à voir », à la différence de la « science » antique. Mais c’est parce que le Dieu vrai donne son autonomie à l’homme, et non pas parce qu’il ne serait qu’une référence abstraite. Le III° Séminaire (Les Psychoses) le dit sans ambages : « Quoi que puissent en penser les esprits qui s’en tiennent aux apparences, ce qui est souvent le cas des esprits forts, et même les plus positivistes d’entre vous, voire les plus affranchis de toute idée religieuse, le seul fait que vous vivez à ce point précis de l’évolution des pensées humaines ne vous tient pas quitte de ce qui s’est franchement et rigoureusement formulé dans la méditation de Descartes, de Dieu en tant qu’il ne peut nous tromper ». Plus précisément : « C’est un acte de foi qui a été nécessaire aux premiers pas de la science … C’est la radicalité de la pensée judéo-chrétienne sur ce point qui a permis ce pas décisif, pour lequel l’expression d’acte de foi n’est pas déplacée, qui consiste à poser qu’il y a quelque chose qui est absolument non trompeur »(42). Et Lacan en viendra à montrer ce Dieu judéo-chrétien comme celui de la parole, celui qui dit je, et qui parle à un sujet qui lui-même a à parler(43). Dieu qui élit.
Le Moi enfin. Il pourrait sembler que là fût le point de divergence radicale entre Descartes et Lacan. Descartes affirmerait le Moi (dans l’ego sum ego existo notamment). Lacan le dénoncerait comme illusion, « fonction de méconnaissance ». C’est certes ce qu’il vise quand il qualifie « le je pense cartésien de participer, dans son effort de certitude, d’une sorte d’avortement »(44), ou qu’il dit que l’erreur de Descartes est « de ne pas faire du je pense un simple point d’évanouissement »(45). Mais Lacan a connu un autre Moi. Je pense à cette envolée sublime, à la fin d’une séance de L’Éthique de la Psychanalyse, quand, à propos de certains usages du pronom d’appel en français, il évoque le Toi ! et le Moi ! : « Qu’est-ce que ce Moi [« que nous répondrons quand quelque chose nous est imputé à notre charge ou à notre compte »] ? demande-t-il, — si ce n’est un Moi d’excuse, un Moi de rejet, un Moi de très peu pour moi ». Et il conclut : « Ainsi, dès son origine, le moi, en tant qu’il s’expulse lui aussi par un mouvement contraire, le moi en tant que défense, en tant que, d’abord et avant tout, moi qui rejette et qui, loin d’annoncer, dénonce, le moi dans l’expérience isolée de son surgissement qui est peut-être à considérer aussi comme son déclin originel, le moi ici s’articule »(46). Disons brièvement : le sujet, ayant ainsi rejeté, psychotiquement, le vrai Moi, celui qui aurait accueilli l’élection, celui qui se serait affronté à son être jusqu’au bout, celui qui aurait assumé la responsabilité, ce sujet se soumet au Sur-moi, et se réduit, déclin originel, au moi narcissique. Mais c’est en tant que Moi vrai de la responsabilité pure qu’on veut le savoir et qu’on va jusqu’au bout du mouvement existentiel décrit par Descartes, et repris par Lacan (c’est celui de la cure).
A partir de ce Moi on pourrait alors s’engager vers ce qui serait, non plus l’idée du savoir nouveau, ni sa réalité, mais sa vérité, dans la philosophie, où ce savoir se poserait comme tel. Je n’en dirai rien, ce n’est pas mon propos ici, sinon pour souligner sa nécessité éthique, politique et historique. Car le Malin Génie n’est rien d’abstrait. Il est le Surmoi. Et le Surmoi non plus n’est rien d’abstrait. Il est le dieu obscur évoqué par Lacan à la fin du XI° Séminaire, quand il dit, à propos de l’Holocauste, qu' »il s'[y] avère que l’offrande à des dieux obscurs d’un objet de sacrifice est quelque chose à quoi peu de sujets peuvent ne pas succomber, dans une monstrueuse capture »(47). Ce qui est sacrifié à ce Dieu obscur, c’est toujours le Moi, celui qui a choisi l’élection, c’est, parmi les peuples, le peuple juif. Là, contre le Moi, s’exerce la « haine de Dieu », la haine contre le vrai Dieu. Dans sa lutte historique la philosophie a à s’opposer, pour la justice, à toutes les formes de l’autre dieu, du dieu obscur, du Surmoi, du Malin Génie.
Comment apparaît dans ces conditions la position de Descartes dans l’histoire ? Sans tenter de rien dire de la succession logique pure des époques de l’histoire, je voudrais simplement donner quelques indications sur la position qu’y prend Descartes, notamment en relation avec la dimension religieuse qu’on vient de mentionner.
Descartes n’est pas Lacan ni Lévinas, qui nous dirigent, chacun à sa manière, vers le savoir nouveau dont il a été question. Il ne vient pas après Heidegger. Il n’a pas reconnu l’être comme signifiance et parole. Il appartient, quoique de manière très particulière, à l’époque de ce que Heidegger appelle la pensée métaphysique.
Non seulement, comme la philosophie médiévale, il assume, dans le monde chrétien en tant que monde historique, ce qui a été ouvert par la Grèce, avec la philosophie et la visée d’une société juste ordonnée par le savoir rationnel pur. Mais il fixe philosophiquement dans ce monde quelque chose de ce que celui-ci a de proprement chrétien : finitude radicale ; subjectivité qui se découvre elle-même, comme principe absolument libre, en rompant avec le monde immédiat ; Dieu créateur (même des vérités éternelles).
Après Descartes, et se réclamant de lui, vient la métaphysique moderne, et son rationalisme. Spinoza, « juif détaché de sa tradition », comme le dit Lacan(48), reçoit la philosophie de Descartes et l’amène vers le monde germanique. Dont le caractère majeur, dit Bernard Bourgeois(49), est la réconciliation du Moi et du Tout, du Moi et du monde. Le Tout alors posé par la subjectivité devenue la vérité (autonomie) perd en fait la finitude radicale introduite par Descartes.
La pensée de l’existence, qui commence avec Kierkegaard, dénonce ce tout du monde et du savoir. Au nom de la finitude, ou encore de la division du sujet (très clairement chez Kierkegaard). Au nom également de l’Autre absolu. Mais, parce qu’elle exclut tout savoir nouveau et toute raison ou autonomie nouvelle (d’où son rejet de Descartes, chez qui elle ne voit pas la même finitude qu’elle-même a proclamée), elle laisse intouché le monde commun, injuste. Qui plus est elle l’absolutise religieusement. Ainsi Heidegger avec le sacré.
Alors, à l’extrême fin de cette « pensée de l’existence », après que la passion de l’injustice et du sacrifice, rejetant l’exigence spirituelle de l’histoire, a conduit jusqu’à l’Holocauste, Lévinas, juif qui assume toute sa tradition et en montre la portée universelle, et qui assume aussi toute l’histoire de la philosophie allemande, ramène la philosophie dans le pays de Descartes, qui est celui de l’objection par le Moi contre le Tout, et il rappelle l’exigence éthique du savoir et de la raison. Alors, après que le Malin Génie a dévoilé dans l’espace social toute sa figure obscène et féroce de Surmoi, s’accomplit le mouvement historique ouvert par Descartes — le monde historique comme monde chrétien ayant enfin adopté la vérité du judaïsme, et atteint par là même la sienne propre. Pour ce nouveau savoir, pour cette nouvelle raison, la psychanalyse, qui a trouvé dans le pays de Descartes, avec Lacan, son sol, est décisive. Elle qui la première a pu décrire tout le jeu du mal, de la pulsion de mort, et montrer comment par la sexualité seule il reçoit sa vérité. Non-sens élevé au sens. Freud lui-même, à la fin de Malaise dans la civilisation, n’attendait-il pas qu’après la montée, qu’il savait, de la pulsion de mort, vînt de la pulsion de vie un acte ? Le savoir serait celui-là.