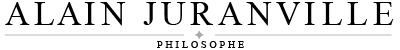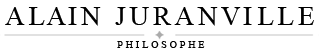Jean-François Marquet.
C’est toujours un bonheur de voir paraître un nouveau livre de vous(1) — une nouvelle pierre du monument philosophique qu’à l’écart des modes, mais attentif aux sommations de l’actualité, vous édifiez depuis une dizaine d’années. Bonheur qui toutefois se nuance pour moi d’un peu de mélancolie : si je vous ai bien compris, en effet, ce livre n’est encore que le quatrième volume d’une série qui doit en comprendre bien d’autres(2) — et je ne peux guère espérer que l’âge m’autorise à en voir le dernier mot. C’est cette appréhension de l’avenir qui a jeté un peu d’ombre sur ma lecture, et aussi, parfois, la difficulté de ranimer le souvenir des analyses contenues dans les trois premiers volumes (publiés en 2000). Si je pouvais me permettre de formuler un vœu, je vous suggérerais volontiers de rédiger, en marge de votre opus magnum, une sorte d’« encyclopédie en abrégé » (pardonnez-moi d’évoquer Hegel !) qui permettrait dès maintenant d’avoir une vue panoramique de votre système, et peut-être d’en mieux pénétrer l’articulation. En effet, si chacune de vos analyses de détail me paraît un chef-d’œuvre de clarté et de précision, on a parfois quelque difficulté à saisir le fil de votre « méthode métaphorique », et le chemin par lequel vous passez d’un terme à l’autre ; en particulier, je ne comprends toujours pas le sens du vocable réalité, par lequel vous redupliquez chaque notion, et les indications de l’Introduction générale(3) me semblent sur ce point un peu trop elliptiques.
Alain Juranville.
Je vous remercie très vivement de votre lecture et je vais essayer de répondre brièvement aux objections que vous allez avancer. Par ce jeu des objections et réponses, nous pourrons renouer avec ce que vous appelez l’« heureux temps de la métaphysique ». En ce qui concerne l’usage que je fais du vocable de réalité, il s’agit là certes d’un aspect très important de la méthode qui est la mienne, tant dans les trois volumes de La philosophie comme savoir de l’existence que dans le présent volume. Pour chaque terme étudié, je distingue en effet, d’une part, ce que tel phénomène, désigné par tel terme conceptuel, est en soi, dans son concept et, d’autre part, ce qu’il est en fait, dans sa réalité.
C’est une distinction classique, constitutive de la philosophie. Distinction entre le concept (ce qu’elle affirme, son pari) et la réalité (ce à quoi elle doit s’affronter). Cette distinction est présente chez Hegel bien sûr, pour lequel la contradiction qui apparaît entre le concept et la réalité se résout naturellement, par soi, la chose n’ayant qu’à rentrer en soi pour y découvrir son identité toujours déjà là. Elle est présente aussi, autrement certes, chez Schelling qui, le premier, affirme l’existence, et pour lequel la contradiction entre le concept et la réalité devient absolue et ne peut plus être résolue que par l’Autre, imprévisiblement. Mais cette distinction devient plus précisément, pour moi qui affirme non seulement l’existence, mais aussi le savoir de l’existence, celle entre, d’une part, la réalité en tant qu’elle s’est entièrement conformée au concept — c’est la réalité telle qu’elle apparaîtra au savoir philosophique, quand les contradictions qui devaient être traversées l’auront été. Et, d’autre part, la réalité en tant que, d’abord, elle se refuse au concept — c’est la réalité brute de l’existant, face à laquelle la philosophie doit mettre en œuvre, toujours à nouveau, sa puissance métaphorique, créatrice de concepts. On voit là combien votre question touche juste, puisqu’au-delà de la distinction concept-réalité, il y a une distinction plus profonde entre deux ordres de réalité, ce qui est le plus réel pour l’existant étant le réel brut, le réel du refus qu’il oppose à l’existence, à la vérité et finalement au concept.
Ainsi, dans le nouveau volume consacré à l’événement, et où celui-ci est présenté comme fait, puis comme occasion, puis comme rupture, le fait lui-même apparaît d’abord (1° section) comme le fait en soi, dans son concept, ce que Schelling appelle le fait pur et Kierkegaard le fait absolu. C’est le fait qui, en tant que totalité constituée avec l’Autre, est par excellence, pour Kierkegaard, le Sacrifice du Christ (totalité de Dieu avec l’homme). Fait qui est avant tout pour Rosenzweig — et plus significativement à mes yeux, parce que Rosenzweig distingue le fait qu’est le judaïsme et l’événement qu’est le christianisme — le peuple juif lui-même. Fait qui est, pour moi, l’histoire entièrement déployée. C’est ce que je viens d’appeler la réalité en tant qu’elle s’est entièrement conformée au concept. Et le fait apparaît ensuite (2° section) comme le fait dans sa réalité, dans sa réalité brute, où se marque le refus d’une telle vérité du fait. C’est le fait empirique, vide de sens, dont se repaît le savoir ordinaire. Avec, au fond de ce fait et de ce savoir, le fait brut du monde païen, quand la totalité rejette l’Autre comme tel. C’est ce que je viens d’appeler la réalité en tant que, d’abord, elle se refuse au concept. Tout le problème étant de voir comment, à partir de cette réalité du fait brut où le concept est refusé, le fait peut s’accomplir conformément au concept. Et l’histoire, se déployer effectivement jusqu’à son terme.
Jean-François Marquet.
Reste que, chez vous comme chez Leibniz, il n’y a que des « parties totales », et il n’est donc pas interdit, à partir de ce seul volume, de tenter de pressentir la structure du tout, traduite, ici, dans le registre de l’événement. Vous articulez l’ensemble de l’histoire autour de deux événements fondamentaux, « l’événement primordial » du Sacrifice du Christ et « l’événement terminal » de la Révolution (p. 33), en lesquels je crois reconnaître la Révélation et la Rédemption de F. Rosenzweig ; si le premier moment — la Création — est absent, c’est ici dans la mesure où pour vous le point de départ n’est pas un acte créateur, mais plutôt ce qui, pour Rosenzweig, relève du « pré-monde », la persistance immémoriale et indéfinie d’une tradition anonyme dont vous soulignez avec insistance le caractère maléfique. Du fait de sa finitude radicale, le sujet ou « l’existant » ne se définit jamais, chez vous, que de sa relation à l’Autre ; mais cet Autre n’est initialement qu’« un Autre faux [= fabriqué], ou idole, ou Surmoi » (p. 655), principe d’une « identité fausse » (p. 17) où l’homme est réduit au statut d’un « déchet » terrifié — terreur qu’il déplace après coup « sur la victime du sacrifice » (p. 389). C’est à ce « système sacrificiel » (notre véritable « état de nature » théologico-politique) que la Révélation va arracher l’existant : d’abord dans l’élection juive qui, pour la première fois, l’institue comme Autre de l’Autre authentique (qui n’est plus puissance muette, mais parole appelante) — puis dans la grâce chrétienne issue de l’événement par lequel l’Autre se fait lui-même, en Christ, objet-déchet (objet a, dirait Lacan), abolissant ainsi l’ensemble du système sacrificiel et nous élevant par là à la « subjectivité vraie » (p. 654). C’est en adhérant à la Révélation par la foi (principe de la troisième grande Révélation, l’islam) que ce sujet devient capable de lui répondre dans l’œuvre, qui est retour à l’objectivité, « la Chose maternelle originelle, mais reconstituée objectivement, aux yeux de tout Autre » (p. 49) : œuvre qui est avant tout l’œuvre politique, le « monde juste » dont l’instauration « révolutionnaire », procédant elle-même non plus d’une révélation particulière, mais du « savoir de l’existence » (cf. p. 409) donne à l’histoire sa clôture. Dans ce « monde social nouveau et juste » (p. 283), « chaque humain [reçoit] sa reconnaissance d’Autre vrai », en même temps que l’ordre sacrificiel passé se trouve conservé, sous une forme désamorcée, dans la permanence de la sexualité et du capitalisme, réduits au statut d’infra-structures.
Tel est le schéma général que j’ai cru pouvoir extraire de votre livre — au prix, hélas, d’un considérable appauvrissement : j’aurais aimé, par exemple, m’attarder davantage sur votre parallèle si brillant et si suggestif entre les étapes de la Révélation et celles de la cure psychanalytique (puisque l’Autre est, en fin de compte, le véritable nom de l’Inconscient). Ce schéma, j’y adhère d’autant plus volontiers que j’ai toujours estimé que le noyau de toute philosophie authentique (ce qu’est assurément la vôtre) était lui-même vrai ; et je suis convaincu, pour paraphraser Leibniz, que la seule erreur des grandes philosophies est de croire que les autres sont fausses. C’est dire que je ne saurais partager votre mode de discussion qui consiste à déclarer « faux » (le mot sans doute le plus fréquent dans votre texte !) le contenu de toutes les doctrines précédentes (y compris pour votre quatuor de prédilection Kierkegaard / Heidegger / Lévinas / Lacan) pour la seule raison qu’elles n’auraient pas poussé jusqu’à la « communauté juste » et qu’elles auraient ainsi, volentes nolentes, conforté l’ordre sacrificiel honni, se mettant par là en contradiction avec elles-mêmes. Il s’agit là, selon moi, d’un argument purement ad hominem, et qui repose, d’ailleurs, sur un présupposé implicite : à savoir que la « communauté juste » constitue la valeur suprême. Or, ce n’est certes pas l’opinion de Kierkegaard, pour qui la valeur suprême est tout simplement le salut personnel (et la catégorie centrale celle de l’Isolé) ; ni celle de Heidegger, pour qui il y va avant tout de l’authenticité (Eigentlichkeit) du Dasein ; ni même pour Lacan, dont l’éthique culmine dans la seule exigence de « ne pas céder sur son désir » (je ne me risquerai pas à me prononcer en ce qui concerne Lévinas). Il se peut que toutes ces quêtes reviennent finalement à une seule : reste que la dimension sociale y est toujours secondaire, ce qui interdit de la poser comme critère de validité interne, sauf à faire de votre « savoir » la mesure de tous les autres. C’est là, je pense, votre arrière-pensée, mais le lecteur n’est pas obligé de vous suivre sur ce point.
Alain Juranville.
Mon idée n’est certes pas de déclarer fausses toutes les doctrines précédentes. Je dirai même plutôt qu’elles sont toutes vraies(4) ! Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’elles apportent chacune comme vérité nouvelle dans la constitution du savoir. Il y a en cela, pour moi, un « progrès » dans l’histoire de la philosophie, un déplacement de l’analyse. Car ce qui a été conquis par une philosophie antérieure est conservé dans celle qui suit — Platon dans Aristote. Et la philosophie qui suit ne fait que dénoncer ce que cette vérité conquise devient en fait pour l’homme fini, la falsification de cette vérité — la sagesse platonicienne, vertu suprême certes, est « trop élevée pour la condition humaine », et la vertu primordiale en fait pour l’homme, celle par laquelle il lui faut commencer, est, aux yeux d’Aristote, la prudence, « capable d’agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain ».
C’est dans cette perspective que je discute avec la pensée contemporaine, tout entière appendue à l’affirmation de l’existence. Selon moi, pareille affirmation ne peut s’accomplir que politiquement, par une rupture radicale avec le système sacrificiel ou paganisme, et une éthique qui ne déboucherait pas sur une politique est vouée existentiellement à se « fausser ». Car le propre de l’existant, c’est d’abord de fuir l’existence, l’ouverture à l’Autre et, avant tout, de fuir cette fuite elle-même. Et ce à quoi l’existant doit viser, c’est certes à ne plus fuir l’existence, et d’abord à ne plus fuir cette fuite, à « s’approprier authentiquement la non-vérité », comme dit Heidegger pour la « résolution ». Or le point ultime de cette fuite de l’existence est, à mon sens, la constitution du système sacrificiel. Tant qu’on ne rompt pas avec ce système, on fuit donc toujours l’existence. C’est du moins ce que je soutiens — et qu’avanceraient Adorno contre Kierkegaard et Lévinas contre Heidegger.
Je dois reconnaître que les penseurs contemporains ont leurs raisons (existentielles — ad hominem, si l’on veut, mais cela ne tient pas à tel homme, à tel penseur, et bien plutôt à l’homme en général) pour dénoncer la falsification que ce serait de vouloir affirmer tel et tel contenu. C’est ainsi, d’une part, que Kierkegaard affirme la finitude radicale de l’existant et sa relation à l’Autre absolu (en l’occurrence expressément Dieu). Et Kierkegaard suppose alors l’identité nouvelle, créatrice qui vient de cet Autre, et le savoir qui découle de cette identité. Mais il exclut toute affirmation de cette identité et de ce savoir, parce qu’une telle identité et un tel savoir se fausseraient (effacement de la finitude radicale et rechute dans la conception hégélienne). Et c’est ainsi, d’autre part, que Marx et Nietzsche affirment, eux, cette identité nouvelle parce qu’ils considèrent que ne pas l’affirmer est aussi une falsification, la « rationalisation » d’une fuite — et même une falsification accrue, sociale, historique. Et Marx et Nietzsche supposent alors la finitude radicale (ils la décrivent dans leurs analyses, du capitalisme chez Marx, de l’esprit de vengeance chez Nietzsche — c’est en cela qu’ils sont des « penseurs de la finitude », non pas thématiquement certes, mais descriptivement), et ils supposent aussi la relation à l’Autre absolu. Mais ils excluent toute affirmation de cette finitude et de cette relation, parce qu’une telle affirmation contredirait (existentiellement) l’affirmation de l’identité nouvelle, créatrice. Avec comme conséquence, c’est ce que je ne cesse de souligner, une nouvelle falsification — et catastrophique cette fois-ci, puisque c’est celle des totalitarismes et de l’Holocauste.
Ce que j’ai donc voulu montrer, c’est que l’époque exige — et que l’inconscient permet — de dépasser les considérations existentielles, légitimes certes, des penseurs contemporains. Et de poser, à la fois, et la finitude radicale (avec la relation à l’Autre absolu qui permet de l’assumer), et l’identité nouvelle (avec le savoir dont elle est le principe).
Jean-François Marquet.
Cela m’amène tout naturellement à évoquer mes réticences non plus cette fois sur la méthode de votre ouvrage, mais sur son contenu. Comme je l’indiquais tout à l’heure, ces réticences concernent non la structure d’ensemble, mais des points de détail précis, et je me limiterai du reste aux deux domaines qui me sont un peu familiers — l’histoire de la philosophie et l’histoire des religions. En ce qui concerne le premier, je ne puis que rester perplexe devant votre résolution toute rimbaldienne d’« être absolument moderne » et d’asseoir votre édifice (qui se veut pourtant l’achèvement de toute la philosophie) sur un corpus réduit presque exclusivement aux pensées post-hégéliennes, et plus précisément aux quatre auteurs majeurs signalés plus haut. La métaphysique, quant à elle, se voit exclue d’emblée (p. 20) comme « savoir anticipateur et faux » — la métaphysique, c’est-à-dire en fait l’ensemble de la philosophie « de Platon à Hegel », von Ionien bis Iena, aurait dit Rosenzweig. Mais si Rosenzweig détruisait lui aussi la métaphysique, c’était avec des « outils nuptiaux » (pour reprendre une formule de René Char qu’affectionnait Jean Beaufret), dans la mesure où, comme j’ai tenté de le montrer ailleurs5, les trois éléments fondamentaux de sa « nouvelle pensée » — l’homme, le monde, Dieu — ne sont qu’une reprise des trois Idées de la raison pure kantienne, elles-mêmes héritées (au prix d’un renversement) des trois domaines traditionnels de la Schuhlmetaphysik (psychologia rationalis, cosmologia rationalis, theologia rationalis — l’ontologie restant posée à part) ; chez vous, au contraire, il s’agit d’une élimination pure et simple où table rase est faite du passé, à l’exception curieusement de la seule « pensée française, Descartes et Pascal en l’occurrence » (p. 342) : en revanche, vous n’hésitez pas à récupérer Marx et Nietzsche, dont on voit mal cependant comment ils peuvent être considérés comme des « penseurs de la finitude ».
Alain Juranville.
Je ne dirai quand même pas qu’entraîné par un rimbaldisme exacerbé et ayant « embrassé l’aube d’été », je serais allé en rêve jusqu’à « sentir un peu son immense corps » (celui de la métaphysique), et qu’« au réveil il était midi » — « moment de l’ombre la plus courte », dit Nietzsche, incipit Zarathoustra. Certes je mène ma discussion décisivement avec Schelling, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Weber, Rosenzweig, Heidegger, Benjamin, Adorno, Lévinas et Lacan. Mais, si je m’en tiens à ces penseurs post-hégéliens, c’est parce que je veux réintroduire, contre leur anti-hégélianisme, l’affirmation d’un effectif savoir philosophique. Tout en reprenant bien sûr, dans ce savoir, les analyses qu’ils ont proposées au nom, plus ou moins expressément, de l’existence. Je veux, avec l’affirmation contemporaine de l’existence, ou encore de l’altérité, ou encore du temps pur, et finalement de la finitude radicale, répéter l’affirmation métaphysique, et éminemment hégélienne, du savoir. C’est ce que permet, je le redis, l’inconscient.
Quant à la métaphysique, je répondrai simplement que la question qui se pose actuellement à la philosophie a cessé de conduire directement, me semble-t-il, à une discussion avec les penseurs de la métaphysique, de l’Ionie à Iéna. Mais la question actuelle qui me fait discuter avec la pensée contemporaine, si elle ne conduit pas directement à une discussion avec les penseurs de la métaphysique, y conduit indirectement — pour autant que peut s’accomplir aujourd’hui l’acte (politique) que la philosophie a tenté dès la Grèce. Suivre les époques de cet accomplissement, et donc déterminer la place que prennent dans l’édifice du savoir les analyses des divers penseurs majeurs, au premier chef les « métaphysiciens », s’impose alors à la philosophie. C’est ce que j’essaierai de faire dans le livre que je prépare en ce moment (en-dehors de l’entreprise générale de La philosophie comme savoir de l’existence), sous le titre : L’actualité de la philosophie. Inconscient, capitalisme et fin de l’histoire.
Jean-François Marquet.
C’est le traitement réservé à Kant qui étonne le plus. Ce philosophe n’a droit en effet qu’à quelques mentions rapides et presque toujours négatives. Pourtant, il est généralement reconnu comme le premier penseur de la « finitude radicale » — à plus juste titre, certes, que Kierkegaard, qui maintient la définition métaphysique de l’homme comme « synthèse d’infini et de fini » ; vous semblez d’ailleurs parfois lui concéder ce titre, mais en n’y voyant finalement qu’une apparence (cf. p. 678 et 686). D’autre part, Kant est le seul dont le système (envisagé sous l’angle théologico-politique) présente avec le vôtre une frappante analogie de structure : même point de départ dans une situation de « mal radical », même conversion libératrice à l’appel d’une voix qui est à la fois celle d’un Tout-Autre et celle de mon identité la plus profonde (la Loi et son énigmatique émetteur), même exigence finale d’une communauté juste. C’est lui en qui je verrais volontiers le véritable patron de toute votre entreprise. Certes, vous avez raison d’affirmer (p. 671 et 686) qu’il ne saurait y avoir pour lui d’« intention diabolique » ; mais cela ne le disqualifie nullement comme penseur de la finitude, bien au contraire : en effet, c’est précisément parce que l’homme est radicalement fini qu’il est incapable d’une volonté absolument mauvaise ( = diabolique), tout comme par ailleurs d’une volonté absolument bonne ( = sainte) — si on laisse à part, comme il se doit, le cas tout à fait singulier du Fils de Dieu.
Alain Juranville.
J’ai beaucoup appris de Kant — ce dont il y a quelques traces au § 17 sur l’éthique. Mais je voudrais répondre à ce qui fait la pointe de votre objection, et qui concerne la finitude radicale. La « finitude radicale » selon la conception kantienne n’est pas la « finitude radicale » selon la conception de la « pensée de l’existence ». La première ne fait que limiter le mouvement naturel de l’homme pour se conformer à son identité toujours déjà là (la raison pure en lui) — c’est la métaphysique. La seconde est ce par quoi l’homme refuse l’Autre duquel pourrait lui venir, imprévisiblement, l’identité vraie de son être, et par quoi il réduit cet Autre à un objet pulsionnel.
Cette finitude radicale-ci, l’existentielle, non pas la kantienne, deviendra, chez Freud, pulsion de mort. Elle est, chez Kierkegaard, désespoir — « auto-destruction impuissante », « torturante contradiction qui consiste à mourir sans cesse, à mourir la mort, [car] le mourir du désespoir se change constamment en vivre »(6). Elle était déjà, chez saint Augustin, ce qu’il appelle, d’un terme repris d’Origène, et que Lacan évoquera à propos de la pulsion de mort, la seconde mort — « Là les hommes ne seront plus avant la mort ni après la mort, mais toujours dans la mort ; et ainsi, jamais vivants, jamais morts. Il n’y aura rien de pis que quand la mort sera sans mort »(7). Elle est l’enfer que l’homme porte en lui, ce qu’il a de volonté absolument mauvaise, diabolique. Car la finitude selon la pensée de l’existence n’exclut nullement l’absolu. C’est ce que souligne par exemple Rosenzweig, qui dit de l’homme méta-éthique (qui n’est pas l’homme éthique kantien) : « La volonté libre se reconnaît dans sa finitude sans renoncer le moins du monde à quelque chose de son absoluité. [Elle] devient volonté de défi »(8).
Volonté diabolique, absolument mauvaise, qui n’empêche pas la volonté sainte, la volonté absolument bonne. Car si la sainteté est, pour Kant, un terme indéfiniment reculé, quelque chose que l’homme ne peut jamais atteindre, elle est, pour la pensée de l’existence, une possibilité toujours déjà donnée en quelque manière. Possibilité que Rosenzweig voyait chez Nietzsche, avec son « saint dire-oui » (« Un homme qui connaissait sa vie et son âme comme un poète et qui obéissait à leur voix comme un saint, et qui était pourtant philosophe »(9)). Et possibilité qui est, par opposition au héros païen « toujours enfermé dans l’identique obscurité du Soi », celle de l’homme total, de « celui qui vit absolument dans l’absolu », de « l’homme ouvert aux choses suprêmes et résolu aux actions suprêmes »(10).
Cette possibilité, pour l’homme, et du mal absolu et du bien absolu, et d’un engouffrement dans un tel mal et d’une ouverture vers un tel bien, est quelque chose que l’histoire contemporaine nous oblige à penser — ce que Freud, à sa manière, évoquait à la fin de Malaise dans la civilisation.
Jean-François Marquet.
Par là, nous avons abordé le terrain de votre philosophie de la religion, et c’est là, à coup sûr, où mes réticences seraient les plus fortes. Vous opposez constamment les « grandes » religions (les « religions mondiales » de Max Weber) à un prétendu paganisme idolâtrique et sacrificiel dont vous ne donnez du reste aucun exemple et qui semble sortir des analyses très surfaites (y compris, hélas, par moi-même jadis) de M. René Girard, bien que ce dernier ne soit, sauf erreur, jamais cité. Comment expliquer, alors, que la philosophie et la démocratie, ces anticipations du « savoir de l’existence » et de la « communauté juste », soient nées dans un milieu aussi parfaitement païen que le monde grec, sauf à évoquer (p. 709 et 726) l’hypothèse vénérable, mais désuète, d’un impact de la Révélation juive (en fait, judaïsme et hellénisme ne se sont rencontrés que sur le tard, à Alexandrie) ?
Alain Juranville.
Je ne pense pas que ce que je dis du paganisme dérive des analyses de René Girard, qui ont certes eu pour moi leur importance. Je ne pars pas, pour le sacrifice (au sens ordinaire du terme — la « réalité du sacrifice »), du désir mimétique, des conflits qu’un tel désir engendrerait, et de l’apaisement de ces conflits par la violence infligée en commun dans la société à une victime désignée. Je pars de la haine. De la haine contre celui que j’appelle l’Autre absolu. Cet Autre que toute la « pensée de l’existence » reconnaît sous des noms divers (Dieu, l’être ou l’Ereignis, le Grand Autre, l’Infini…), et qui seul permet à l’homme de dépasser sa finitude radicale, son refus de l’existence, et d’accéder à une acceptation de cette existence.
Pareille haine fait produire, à la place de cet Autre, un Autre absolu faux ou idole ou dieu obscur ou Surmoi. Je rappelle toujours à ce propos la formule de Lacan : « Le Surmoi est haine de Dieu, reproche à Dieu d’avoir si mal fait les choses ». Idole qui est primordialement la mère, la Mère-Nature ou la Terre-Mère, la Δη-μήτηρ toute-puissante et toute-jouissante. Et qui est finalement la complémentarité mythique des sexes, le « rapport sexuel » dénoncé par Lacan et par Lévinas comme illusionnant, les noces de la terre et du ciel dont parle Heidegger lui-même. La fabrication d’une telle idole est le premier aspect du paganisme.
La violence sacrificielle est le second aspect du paganisme. Violence exercée par la communauté contre la victime, prétendument par amour pour le dieu, auquel on veut offrir ce qu’on a de plus précieux. Violence dont doit se sentir menacé quiconque voudrait s’affronter à son existence, advenir comme individu et rompre avec les modèles sociaux traditionnels. C’est la violence dont Lacan montre, à la toute fin de son séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, la répétition monstrueuse dans l’Holocauste.
Un tel paganisme devant lequel, Schelling le rappelle, un Grec comme Thémistocle était horrifié, n’a rien à faire avec ce qui est introduit par Socrate sous le nom de philosophie, et qui ouvre l’espace de l’individu. La philosophie grecque est, selon moi, quelque chose de non païen dans un monde certes encore païen. Je dirais que la philosophie est, dans le monde antique marqué par la condamnation de Socrate, présente, mais non reconnue. Un symptôme. Une « écharde dans la chair ». De même que le judaïsme. Dès l’apparition de la philosophie, et bien avant Philon d’Alexandrie, judaïsme et philosophie sont, au-delà de toute hypothèse de la « science historique », essentiellement liées. Comme saint Augustin l’a bien dit.
Jean-François Marquet.
Je suis tout aussi réservé sur votre distinction entre les « religions révélées » et les « religions instituées par l’homme », parmi lesquels vous rangez, entre autres, le bouddhisme et l’hindouisme, qui se sont toujours présentées comme des religions révélées (on pourrait dire la même chose, avec quelques restrictions, du taoïsme tardif) ; d’une manière générale, d’ailleurs, je ne vois pas ce que peut être une religion instituée par l’homme », pas plus qu’une langue instituée par l’homme.
Alain Juranville.
Votre question sur l’origine des religions, et sur la relation langues-religions, est d’une ampleur considérable. Et je ne vois pas qu’il me soit ici possible d’y répondre comme il conviendrait. Je me bornerai à quelques considérations qui découlent de l’affirmation de l’existence.
Cette affirmation implique une hétéronomie fondamentale, et que la vérité soit d’abord en l’Autre absolument Autre, et vienne d’abord de cet Autre. Mais elle implique également une autonomie nouvelle à partir de cette hétéronomie — et je précise avec l’inconscient : une autonomie qui peut se poser comme principe du savoir.
Dès lors on doit conclure qu’il y a des religions révélées. Et là je parle de ce qu’on appelle classiquement les religions révélées (judaïsme, christianisme et islam). Car l’Autre absolu est Esprit et précisément Personne, et c’est comme tel qu’il se révèle, et ne peuvent être appelées révélées que les religions où il se donne ainsi. De telles religions sont certes ensuite instituées par les hommes, mais c’est second.
Mais on doit conclure aussi qu’il y a des religions vraies instituées par l’homme. Tel ou tel, dans sa sainteté, accueille ce qui lui vient de l’Autre absolu, là même où cet Autre ne se pose pas comme Personne. Pareille religion vraie instituée par l’homme est par excellence le bouddhisme — et, à partir de là, toutes les grandes religions de l’Asie (en correspondance structurale avec les religions révélées).
Et on doit conclure enfin, parce que les Révélations du Dieu personnel se font contre des religions instituées par l’homme, mais fausses, qu’il y a de telles religions fausses. Ce sont les religions païennes, sacrificielles, les religions « naturelles » des hommes. Avec certes, à chaque fois, plus ou moins de vérités spirituelles, mais un esprit fondamentalement faux qui se répand sur tout et à propos duquel ne vaut pas ce qu’Adorno appelle le « moment matérialiste de Schelling », la « contraction de Dieu ».
Je garde donc la distinction rosenzweigienne entre judaïsme et christianisme d’une part, et « religions fondées » d’autre part.
Mais je désigne le judaïsme et le christianisme comme « religions » révélées (le judaïsme comme religion révélée par excellence — Schelling le disait à sa manière, et je précise quant à moi : parce qu’accueillir la révélation suppose l’élection). Et j’y ajoute l’islam. Je ne parlerai pas comme Rosenzweig du « paganisme agressif du croissant », et cela pour des raisons non pas idéologiques, mais philosophico-structurales.
A propos du bouddhisme et des religions asiatiques, je dis qu’elles sont certes des religions « fondées », instituées par les hommes, mais vraies. Je ne dirai pas avec Rosenzweig que « c’est le destin des fidèles de Bouddha comme de Lao-Tseu qu’un paganisme en fleur envahisse de nouveau les blocs de pierre figés de leurs non-pensées ». Ou alors que cette repaganisation a été le destin aussi, dans l’histoire, du christianisme (avec la gnose, jusqu’à l’holocauste) et de l’islam (jusqu’au terrorisme).
Quant à l’opposition paganisme-révélation, constitutive du projet rosenzweigien dans L’Etoile de la Rédemption, je la conserve tout entière.
Jean-François Marquet.
Au sein de votre répartition, les rapprochements que vous opérez sont parfois vertigineux et le démon de l’analogie vous pousse à des audaces dignes de la défunte Naturphilosophie. On ne voit pas ce que peuvent avoir de commun le taoïsme et le christianisme (la grâce est le contraire du « non-agir »), le confucianisme et le judaïsme, l’hindouisme (soit dit en passant, la plus sacrificielle des religions) et l’islam (p. 192 sq) ; on ne voit pas davantage pourquoi, à l’intérieur du christianisme, vous liez plus particulièrement le catholicisme et la grâce, le protestantisme et l’élection, l’orthodoxie et la foi (p. 527 sq), avec, du coup, pour cette dernière confession, un prolongement plutôt inattendu en direction de l’islam : je penserais plutôt que ces trois notions s’interpénètrent dans toutes les formes de christianisme, un élu n’étant jamais que celui qui a reçu la grâce de croire.
Alain Juranville.
Bien sûr la grâce, l’élection et la foi, comme conditions venues de l’Autre et permettant l’autonomie de l’homme, sont présentes chacune en toute grande religion, et notamment dans toutes les confessions chrétiennes — sans parler de la philosophie, de la psychanalyse, etc.
La grâce qui est acte de la seule manière dont un acte effectif est possible, par l’effacement de soi, par le non-agir (au sens de ne pas avoir la volonté illusoire d’agir par soi seul), est caractéristique du taoïsme (c’est l’« efficace du non-agir », le wu wei — « La perfection suprême semble imparfaite, Son acte n’a pas de cesse. La plénitude suprême semble vide, Son acte n’a pas de limite », dit le Tao-tö king, et Lacan dirait la même chose du psychanalyste, ou du saint). Et elle est caractéristique aussi du christianisme. Autrement certes, parce que la grâce chrétienne a une portée historique, de mise en question radicale du monde antique. Le christianisme implique bien également l’élection et la foi. Mais l’élection était — et est — proclamée par le judaïsme. Et le décisif du christianisme, ce qui faisait que la philosophie, au lieu d’être symptôme, pouvait désormais être socialement reconnue, était — et est — la grâce.
Quant aux confessions chrétiennes, je dirai brièvement que la grâce est toujours menacée de se fausser — et que cette falsification vaut notamment pour la gnose, comme si le Christ avait souffert à la place des autres, et qu’à partir de là les hommes fussent sauvés du mal, sans plus avoir rien à faire. C’est ce que le judaïsme (cf. Lévinas), mais aussi le christianisme protestant (cf. Weber), ont reproché au christianisme traditionnel avec sa grâce sacramentelle, au catholicisme — qui, bien sûr, en soi, a une vérité pure. Je ne pense pas soutenir quelque chose d’aventuré quand je rejoins Weber disant que l’éthique protestante a particulièrement insisté sur l’élection, et sur la référence aux personnages bibliques. Et la proximité de l’orthodoxie et de l’islam, proximité par la foi qui dirige vers une communauté nouvelle, peut s’éclairer, je crois, par l’impuissance de la première orthodoxie, la byzantine, face aux avancées du monde musulman, jusqu’à la prise de Constantinople — la deuxième orthodoxie, la russe, qui a réagi au nom du christianisme, conservant la même relation évidente à la communauté, au monde, au mir.
Jean-François Marquet.
Il conviendrait de s’arrêter aussi sur votre théorie des quatre discours (discours du peuple, du maître, du clerc et de l’individu ou de l’analyste), mais j’avoue que, tout comme pour la théorie analogue de Lacan (qui n’est d’ailleurs qu’un ajout tardif), j’ai quelque mal à la situer dans l’économie d’ensemble du système. Je noterai simplement le caractère un peu surprenant du lien établi (p. 735) entre le « discours psychanalytique » (celui, donc, de l’individu) et la « Révélation islamique », dont vous soulignez plutôt, d’habitude, la dimension sociale ; et il n’est pas toujours facile de distinguer le rôle du « maître » et celui du « clerc », puisque l’un et l’autre semblent fonctionner également au niveau de la Révélation : la nuance subtile introduite entre un « essentiel discours du maître », qui serait du côté du « monde juste », et un « ordinaire discours du maître », qui présiderait au contraire au système sacrificiel (p. 462-463), ne contribue pas vraiment à éclairer les choses.
Mais — et j’en reviens par là au début de mon propos — je ne doute pas qu’une logique profonde et rigoureuse ne donne un sens à ces apparentes étrangetés. Et je conclurai simplement par ces lignes que Roger Martin du Gard écrivait à Louis Massignon à propos d’un de ses livres : « Ne regrettez pas votre exemplaire, mon cher ami. S’il est tombé entre des mains profanes, nul, du moins, ne pouvait le lire avec une plus respectueuse incompréhension, ni le conserver en souvenir de vous avec une plus fidèle amitié »(11).
Alain Juranville.
Mes quatre discours viennent certes des quatre discours de Lacan, mais abordés cette fois-ci du point de vue de la philosophie, et donc de l’histoire. Ils constituent, selon moi, les quatre structures fondamentales qui organisent toute société et à partir desquelles peut se comprendre l’intervention historique de la philosophie — c’est dire qu’il s’agit là du plus vif de ce que je veux dire. Ils correspondent aux quatre modes de l’activité sociale selon Weber (traditionnelle, rationnelle en finalité, rationnelle en valeur et émotionnelle). Ces structures sociales fondamentales sont autant de rapports à l’histoire, c’est-à-dire au mouvement par lequel peut advenir la société juste que veut la philosophie. Rapports d’abord de refus de l’histoire — c’est la forme ordinaire et fausse de ces discours. Mais rapports qui peuvent devenir d’acceptation de l’histoire — c’est l’éventuelle vérité de ces discours.
L’histoire commence, d’une part, quand le discours de l’individu — au lieu d’être celui par lequel l’individu se rejette lui-même et veut le système sacrificiel — advient dans sa vérité. Cela s’est produit pour la première fois avec Socrate, et se répète définitivement dans le monde actuel, avec le discours psychanalytique. Mais ce discours vrai de l’individu ne pose pas comme tel son savoir rationnel — c’est le non-savoir proclamé par Socrate — et ne change donc pas le monde. Et l’histoire commence, d’autre part et surtout, quand, au-delà du discours de l’individu, le discours du clerc, de son côté, advient dans sa vérité, en posant comme tel le savoir présent dans le discours vrai de l’individu. Cela s’est produit pour la première fois avec Platon assumant jusqu’au bout la pratique socratique, et cela a à se répéter aujourd’hui dans un discours philosophico-clérical qui se rapporte à la psychanalyse.
Bien sûr la philosophie doit reconnaître qu’il y aura toujours ces quatre discours. Elle doit renoncer à vouloir organiser toute seule le monde social. Sinon elle se réduirait à l’idéologie. Elle doit donc poser chacun des autres discours dans sa vérité propre (et dans la fonction sociale qu’il peut remplir). Mais c’est en tout cas comme discours, et parmi des discours, qu’elle intervient et fait histoire. Là est la pointe de ce que j’ai voulu dire dans ce volume.