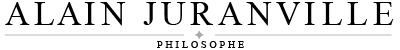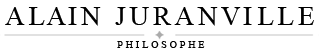Pourquoi ce titre pour une conférence prononcée lors d’un colloque consacré au bilan du structuralisme ? Parce que la portée décisive du structuralisme est, selon moi, d’avoir permis à la philosophie de se penser à nouveau comme savoir. Et parce qu’une structure à six termes, une structure sénaire, doit apparaître alors, pour un tel savoir, comme la structure fondamentale. Celle même que Franz Rosenzweig a dégagée dans son ouvrage majeur L’Étoile de la Rédemption. Le savoir philosophique est, à sa manière propre, non pas mythique et religieuse, mais spéculative et philosophique, l’Étoile de la Rédemption, l’Etoile à six branches, l’Etoile de David. Ce que je voudrais ici justifier quelque peu.
Je m’attacherai, dans un premier temps, au structuralisme, et à la portée qu’on doit lui donner, me semble-t-il, dans l’histoire de la philosophie. Je m’occuperai, dans un second temps, de la structure elle-même. Structure que je présenterai d’abord en soi, dans son concept. J’essaierai de montrer que la structure vraie fait parcourir les temps évoqués en titre, jusqu’à atteindre, au-delà même du Quaternaire de l’œuvre (1, 2, 3, 4) et du Quinaire de l’histoire (1, 2, 3, 4, 5), le Sénaire du savoir (1, 2, 3, 4, 5, 6). Structure dont j’évoquerai ensuite — mais ce ne seront que quelques indications conclusives — la réalité, la manière dont elle peut, effectivement, s’accomplir.
Que veux-je dire du structuralisme, de ce mouvement d’idées qui s’est développé autour des sciences humaines naissantes ? Je ne m’accorderai pas forcément avec ce que ce mouvement dit de lui-même. Je m’occuperai de ce qu’il a apporté à la philosophie. Je dirai du structuralisme qu’il ne prend pas sa portée, comme on l’a trop dit, de mettre en question la « pensée métaphysique » et son « sujet de la représentation » (ou du « concept spéculatif ») : cette mise en question n’a pas attendu le structuralisme, elle avait déjà été effectuée par toute la pensée contemporaine depuis Kierkegaard et Marx (et même déjà Schelling, le dernier Schelling). Je dirai du structuralisme qu’il ne prend pas non plus sa portée de mettre en question la phénoménologie de Husserl et sa « conscience constituante » : cette mise en question n’a pas attendu non plus le structuralisme, elle avait été déjà effectuée, dans la pensée contemporaine, par Heidegger. Je dirai du structuralisme qu’il prend sa portée de mettre en question toute la pensée contemporaine, pensée que j’appellerai pensée de l’existence et qui a en propre, à la fois, d’affirmer l’homme, le sujet humain, comme existant, et d’exclure, pour cette existence, toute raison, tout savoir. Certes le structuralisme ne proclame pas le savoir de l’existence, mais il montre qu’il y en a un. Et il appartient à la philosophie, après le structuralisme, de poser ce savoir.
A) Que dire, d’abord, de la pensée contemporaine comme pensée de l’existence ?
J’aurais voulu la présenter dans son développement, dans sa dialectique propre. Parler d’abord de Kierkegaard, ensuite de Marx, Nietzsche et Husserl, enfin de Heidegger. Pour respecter les exigences du colloque, je limiterai mon propos. Pour la pensée de l’existence, je garderai simplement ceci. Affirmer l’existence, la vérité de l’existence, c’est affirmer, d’une part, qu’au-delà de toute identité déjà là, anticipative, hors temps, la vérité surgit d’abord en l’Autre, imprévisiblement, et que c’est de cet Autre que le sujet doit recevoir son identité vraie, elle-même temps pur et tournée vers tout Autre, ex-sistante. D’autre part, que pareille existence vers l’Autre, le sujet humain toujours d’abord la refuse — ce qui caractérise sa finitude radicale. Enfin, que le sujet, le fini, ne peut être ultimement libéré de ce refus, et mis en position d’accepter l’existence, que par un Autre absolument Autre, au-delà de toute humaine finitude (Dieu chez Kierkegaard, l’être ou l’Ereignis chez Heidegger, le Grand Autre chez Lacan, l’Infinichez Lévinas). On voit donc qu’affirmer l’existence, c’est aussi affirmer des rapports à l’existence. Mais la pensée de l’existence exclut tout rapport à l’existence qui serait savoir posé comme tel de cette existence : ce serait oublier la finitude. Et Heidegger, parti de la philosophie, en vient même, parce que celle-ci se veut constitutivement un tel savoir, à proclamer la « fin de la philosophie » elle-même.
B) Que dire, dès lors, du structuralisme ?
J’aurais voulu le présenter lui aussi dans son développement.
D’abord avec Saussure et la linguistique, science de l’homme comme objet, et où l’existence vers l’Autre absolu est supposée, sinon certes posée.
Ensuite avec Lévi-Strauss et l’anthropologie, science de l’homme comme sujet, et où non seulement l’existence est supposée, mais aussi le rapport problématique à cette existence — ce qui caractérise l’homme comme être social. Lévi-Strauss à ce propos introduit déjà l’inconscient et (pensons au thème de notre colloque) distingue alors norme et structure, celle-là consciente, celle-ci fondamentalement inconsciente. « Les modèles conscients, qu’on appelle communément des “ normes ”, comptent, dit-il ainsi, parmi les plus pauvres qui soient, en raison de leur fonction qui est de perpétuer les croyances et les usages, plutôt que d’en exposer les ressorts1« (2). Et il poursuit : « Plus nette est la structure apparente, plus difficile devient-il de saisir la structure profonde. L’ethnologue n’aura garde d’oublier que des normes culturelles ne sont pas automatiquement des structures ». Mais Lévi-Strauss exclut que le rapport de l’homme au symbolique, à l’existence, puisse le conduire jamais jusqu’à la conscience absolue que veut la philosophie. Il dénonce là l’illusion de l’histoire, illusion constitutive, selon lui, de la philosophie. D’où son arrêt aux sociétés primitives ou traditionnelles.
Enfin j’aurais montré l’accomplissement du structuralisme avec Lacan et la psychanalyse. La psychanalyse, science de l’homme comme Autre. Et, par là même, la psychanalyse, on le verra, tout autre chose aussi qu’une science de l’homme. Même si nulle linguistique ni anthropologie structurales n’eussent été possibles, hors un monde historique où la psychanalyse devait faire son apparition. Certes Lacan reprend, dans sa réinterprétation de Freud, et dans son projet de justifier l’hypothèse de l’inconscient, les considérations structurales apportées par la linguistique saussurienne (« L’inconscient est structuré comme un langage ») et par l’anthropologie lévi-straussienne.
Mais Lacan ne se borne pas à supposer l’existence, et le rapport problématique à l’existence (au symbolique, à l’inconscient), il s’installe, lui, dans un tel rapport. Car il a affaire au travail de la cure. Et il dégage alors comme telle la vérité de cette existence, rompt avec toute positive « science de l’homme », et rejoint la pensée philosophique contemporaine. Parce que l’Autre n’est plus simplement chez lui ce que l’on peut, partant de la philosophie, retrouver décrit, sinon nommé, dans la linguistique saussurienne ou dans l’anthropologie lévi-straussienne, mais ce que le sujet doit poser en acte. L’Autre qui est reconnu, dit-il, et non pas connu(3). L’Autre qui est certes le fait, le réel de la structure, mais qui n’existe que comme voulu et aimé, par et pour le sujet éprouvant sa finitude radicale(4). D’où la référence de Lacan à la « pensée de l’existence » (il la désigne lui-même ainsi), et notamment sa référence, outre Heidegger, à Kierkegaard. Ainsi : « C’est d’une exténuation philosophique traditionnelle, dont le sommet est donné par Hegel, que quelque chose a rejailli sous le nom d’un nommé Kierkegaard. Vous savez que j’ai dénoncé, comme convergente à l’expérience bien plus tard apparue d’un Freud, sa promotion de l’existence comme telle »(5).
Lacan cependant, même s’il reconnaît la vérité de l’existence, même si, pour cette existence essentielle, il suppose un savoir (le même que celui de Saussure et de Lévi-Strauss), exclut toujours que cette vérité puisse être posée comme telle, dans un savoir lui-même se posant comme tel, dans un savoir philosophique.
C) Que dire enfin de la philosophie après le structuralisme ?
J’aurais voulu la montrer réaccédant à partir de là à sa vérité de discours rationnel pur, et de savoir qui se sait.
J’aurais commencé avec Lévinas. Lévinas qui s’élève, au nom de l’éthique et de la relation à l’Autre fini, au prochain, contre Heidegger. Certes Lévinas a tort (tort consciemment) contre la lettre de Heidegger, quand il fixe Heidegger à sa visée initiale d’une ontologie. Il a tort, quand il refuse de voir la relation entre l’être et l’étant comme altérité pure et préfère parler d’ « amphibologie de l’être et de l’étant »(6). Mais il a, du point de vue de la philosophie, raison contre les conséquences du propos heideggérien confortant l’ordre traditionnel-mythologique et sa violence. Raison d’en appeler, contre cette violence, à la violence douce de la bonté qui « détruit sans transporter dans des musées les autels érigés aux idoles du passé pour des sacrifices sanglants », qui « brûle les bosquets sacrés où se répercutent les échos du passé »(7). Raison de dénoncer dans le sacré heideggérien l’ « éternelle séduction du paganisme »(8). L’Infini (l’Autre absolu) selon Lévinas n’est pas l’être ou l’Ereignis heideggérien ; il veut expressément n’être rencontré qu’en l’Autre humain, dans le visage de l’autre homme ; il est l’ « Absent absolument révolu »(9) dans la trace duquel est ce visage.
Et Lévinas en vient alors à parler, pour cette relation à l’Autre, de Dire. De signification (« structurée comme l’un-pour-l’autre », dit-il mimant Lacan). De substitution (pour lui, « trope contradictoire de l’un pour l’autre » — c’est la métaphore —, encore Lacan). D’inconscient même (« C’est là le sens de l’inconscient, nuit où se fait le retournement de moi en soi sous le traumatisme de la persécution – passivité plus passive que toute passivité, responsabilité, substitution »). Et aussi de raison (« Raison, comme l’un-pour-l’autre ! »(10), s’exclame-t-il). Et finalement de philosophie, de philosophie à nouveau. Qui certes, comme Dit, ne peut éviter de trahir le Dire. Mais qui a en propre, comme philosophie, comme discours philosophique, de travailler sans cesse à réduire cette trahison, d’accueillir sans cesse l’objection de l’Autre, l’objection qu’est l’Autre.
Lévinas cependant exclut lui aussi que le savoir rationnel qu’est le discours philosophique puisse se poser comme tel, comme savoir effectif, effectivement reconnu. Certes, selon Lévinas, au-delà de Heidegger, il faut, pour l’Autre, vouloir le savoir. Mais il faut aussi, pour l’Autre, ne pas poser comme tel ce savoir. Car « se communiquer, c’est s’ouvrir certes, dit-il, mais l’ouverture n’est pas entière, si elle guette la reconnaissance »(11). Guetter la reconnaissance, a fortiori la supposer, ce serait à nouveau se fermer à l’Autre.
Je serais ensuite revenu vers Lacan. Car Lacan n’est pas simplement celui par qui s’accomplit le structuralisme. Il est aussi celui qui présente la psychanalyse comme discours, et qui peut, à partir de là, au nom de la psychanalyse, dénoncer, de même que Lévinas, la tentation toujours menaçante d’un retour au paganisme. Ainsi quand, à l’extrême fin du séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, il dit du « drame du nazisme » qu’il est « cette résurgence par quoi il s’avère que l’offrande à des dieux obscurs d’un objet de sacrifice est quelque chose à quoi peu de sujets peuvent ne pas succomber, dans une monstrueuse capture »(12). Capture par la « fascination du sacrifice ». D’où déjà, dans le séminaire L’angoisse, le reproche fait à Lévi-Strauss d’avoir « vidé » le « totémisme » de son « contenu passionnel »(13).
Or si, pour Lacan, le discours psychanalytique, celui qui dit l’inconscient, peut arracher à cette fascination, c’est parce que ce discours oppose, à l’ « effet de fascination », son « effet de sens », son sens(14). Sens qui se caractérise comme « consistance », consistance du « dire » — Lacan parle, pour cette consistance, du nœud borroméen où les trois termes constitutifs, réel, symbolique, imaginaire, sont noués ensemble. Sens qui est une raison (« une nouvelle raison ») et qui permet au discours psychanalytique de montrer l’inconsistance des autres discours, fascinateurs. Lacan a donc posé, au-delà de Lévinas qui la tait, une raison nouvelle et vraie, existante. Ce qui serait l’unité même de la structure.
Mais Lacan refuse de poser comme telle, philosophiquement, cette raison. Pour lui, si le discours psychanalytique peut arracher à la fascination, libérer celui qui le reçoit, c’est ultimement parce que ce discours ne pose pas sa raison comme telle, parce que le psychanalyste ne se donne que comme non-savoir, déchet, comme, selon sa formule, « objet a ». Lacan exclut donc toujours le discours philosophique, où la raison se poserait comme telle. Ce qu’exprime très clairement la célèbre théorie des quatre discours. Où les autres discours fondamentaux que celui de la psychanalyse peuvent avoir une réalité (et une fonction) sociale. Mais où ces discours (dont celui de la philosophie) ne font passer aucune vérité à ceux auxquels ils sont adressés, entretenant simplement la soumission fascinatoire selon tel ou tel mode.
J’aurais enfin, au-delà de Lacan, repris expressément le point de vue de la philosophie elle-même. Car Lévinas, dénonçant l’ordre traditionnel-sacrificiel, en vient certes à affirmer le discours, éminemment celui de la philosophie ; mais il exclut tout discours qui serait savoir effectivement reconnu. Et Lacan, dénonçant lui aussi l’ordre traditionnel-sacrificiel, affirme lui aussi le discours, et le montre même comme savoir effectivement reconnu ; mais il n’affirme ainsi que le discours psychanalytique. Dans l’un et l’autre cas, le discours philosophique, seul à pouvoir, s’il était effectivement reconnu, s’opposer à l’ordre traditionnel et instituer le monde juste, rationnellement juste, est toujours exclu. Il faut donc, du point de vue de la philosophie, se demander si l’exclusion par Lacan du discours philosophique ne tient pas à son point de départ dans le discours psychanalytique, et si l’on ne pourrait pas montrer, pour le discours de la philosophie, la même reconnaissance effective et objective que Lacan a montrée pour celui de la psychanalyse.
Or ce qui permet cette reconnaissance — je renvoie à ce propos à La philosophie comme savoir de l’existence(15) —, c’est la grâce – grâce faite à l’Autre. D’une part la grâce du discours psychanalytique qui, taisant sa raison, s’efface comme savoir. Grâce faite au sujet individuel. D’autre part la grâce du discours philosophique qui lui, posant sa raison, s’efface comme pouvoir. Grâce faite au sujet social. Grâce qui dirige vers l’Autre absolu vrai, celui-ci pouvant seul, comme Dieu des religions révélées, faire reconnaître à tous le savoir vrai ; et grâce qui, en même temps, pose la vérité de tous les discours fondamentaux dans lesquels le sujet en vient, comme social, à s’exprimer.
Alors le savoir philosophique peut s’affirmer, avec sa méthode, la logique qu’elle déploie, et la structure que cette méthode suppose. Structure ultimement sénaire. Car le ternaire, ternaire de l’absolu, ternaire retrouvé par Lacan dans son nœud borroméen, doit être posé deux fois, répété, pour et par le fini. Après Rosenzweig, évoquons Lacan lui-même à la dernière séance de son séminaire R.S.I. (Réel, Symbolique, Imaginaire)(16). Il entame ainsi cette séance : « Il n’y a pas d’états d’âme. Il y a dire à démontrer. Et, pour promouvoir le titre sous lequel ce dire se poursuivra l’année prochaine si je survis, je l’annoncerai – 4, 5, 6. Cette année, j’ai dit R.S.I. Pourquoi pas 1, 2, 3, nous irons au bois ? Vous savez la suite – 4, 5, 6, cueillir des cerises, 7, 8, 9, dans mon panier neuf. Je m’arrêterai à 4, 5, 6. Pourquoi ? ». A cette question il ne répond que plus loin, et de manière allusive : « Je viens d’introduire le mot de nomination. Le moins qu’on puisse dire, c’est que, pour mon nœud, la nomination est un quart élément. A s’engager dans ce quatre, on trouve une voie particulière qui ne va que jusqu’à six ». Et les derniers mots du séminaire de cette année-là apportent une ultime précision, jamais elle-même développée : « C’est entre ces trois nominations, nomination de l’imaginaire comme inhibition, nomination du réel comme angoisse, nomination du symbolique comme symptôme, c’est entre ces trois termes que j’essaierai l’année prochaine de m’interroger sur ce qu’il convient de donner comme substance au Nom-du-Père ». Réel, symbolique, imaginaire, puis nomination, d’abord du réel (4), puis du symbolique (5), enfin de l’imaginaire (6).
Essayons maintenant de justifier plus attentivement ce sénaire en présentant les éléments essentiels de ce qui serait l’analyse de la structure.
D’abord la structure en soi, dans son concept.
Qu’est-ce qu’une structure ? Comment la définir ?
Je ne m’attacherai guère aux définitions qui en ont été proposées dans le cadre ou dans la mouvance du structuralisme. Toutes justes certes, mais qui ne sont en rien la définition qu’il faut attendre, à mon sens, d’un concept philosophique, spéculatif. Ainsi pour Lévi-Strauss quand il dit que « les recherches de structure ne revendiquent pas un domaine propre, mais constituent plutôt une méthode »(17), et quand il précise : « Une structure offre un caractère de système. Elle consiste en éléments tels qu’une modification de l’un d’entre eux entraîne une modification de tous les autres ». Et de même pour L. Hjelmslev qui parle de la structure comme d’une « entité autonome de dépendances internes »(18), ou pour P. Ricœur selon lequel « une structure peut être définie comme un ensemble clos de relations internes entretenues entre un nombre fini d’éléments »(19).
Je dirai que le concept de structure prend son sens de son rapport à celui de forme. Dont il a été distingué par la pensée contemporaine. Certes la structure est forme, mais elle n’est pas simplement forme. Car la forme, non pas certes en soi, mais pour le sujet existant, irrésistiblement devient forme s’appliquant à l’avance à n’importe quel contenu, à n’importe quel réel. Forme du formalisme. La structure est forme en tant que celle-ci laisse place au contraire au réel imprévisible, en tant qu’elle se constitue à partir d’un tel réel. Forme, dirai-je, et en même temps réalité. Selon une définition, notons-le, qui pourrait alors s’articuler systématiquement, et non pas vaguement, avec celles de méthode (forme et en même temps savoir), de système (forme et en même temps totalité), de relation (altérité et en même temps réalité), de fonction, etc.
Donnons de notre définition une première justification par l’histoire de la philosophie. En faisant une brève référence à Wittgenstein et à son Tractatus (20). Que dit Wittgenstein de la structure ? En 2.031, nous lisons : « Dans l’état de choses les objets se rapportent les uns aux autres d’une manière déterminée ». En 2.032 : « La manière dont les objets tiennent ensemble dans l’état de choses est la structure de l’état de choses ». En 2.033 enfin : « La forme est la possibilité de la structure ». Où nous rejoignons bien notre définition. Car, pour Wittgenstein, le terme décisif et premier n’est pas le possible ici indiqué, qui ne vaut que dans l’espace logique, celui des relations internes ou pseudo-relations. Mais le réel imprévisible des états de choses (ou encore des propositions élémentaires) dans lesquels les objets (ou encore les noms) s’enchaînent les uns aux autres selon des relations externes, véritables. Réel de l’existence, avec sa forme vraie — les relations externes. Tandis que les relations internes, évoquées par Ricœur, n’apparaissent qu’a posteriori, dans une structure qui tourne au formalisme(21).
Donnons maintenant de notre définition une justification plus phénoménologique.
La structure est certes, comme le dit Littré, la « manière dont un édifice est bâti ». Et l’on parle de structure pour un bâtiment architectural (une cathédrale), mais aussi pour ce type de bâtiment particulier qu’est un navire. Et puis, au-delà, pour un corps vivant, un cristal, un rocher, une phrase, un discours. A chaque fois, et plus explicitement pour les exemples initiaux où il est question de bâtir, la structure aura dû prendre en compte le poids des choses et des mots, la pesanteur du réel en général, pour constituer finalement, à partir d’éléments différents, quelque chose qui tienne, une forme issue du réel, mais qui laisse aussi passer le réel qu’elle n’a pas recueilli en elle.
C’est ce qui se voit très clairement sur l’exemple du pont (pensons à Montaigne, cité par Littré, et qui parle de la « belle structure du Pont-Neuf de nostre grande ville »). Exemple par excellence, puisque dans le cas du pont les éléments qu’il s’agit, par la structure, de faire tenir ensemble, non seulement tendraient à se séparer, mais sont d’emblée — les rives — expressément séparés.
J’évoquerai à ce propos Heidegger qui, dans « Bâtir habiter penser », propose lui-même, comme « exemple » de « chose construite », un pont. Pont dont la puissance propre (commune à toutes les choses, au Quadriparti des choses, nous y reviendrons) est de rassembler – et cela à travers même ce qui ultimement sépare, la mort. « Le pont, dit ainsi Heidegger, rassemble autour du fleuve la terre comme région… Là même où le pont couvre le fleuve, il tient son courant tourné vers le ciel, en ce qu’il le reçoit pour quelques instants sous son porche, puis l’en délivre à nouveau… Le pont conduit les chemins hésitants ou pressés, afin que les hommes aillent sur d’autres rives et finalement, comme mortels, parviennent de l’autre côté… Le pont rassemble, car il est l’élan qui donne passage vers la présence des divins « (22).
J’évoquerai là aussi Rosenzweig. Parlant du pont que le Soi, le héros tragique, dans son défi, coupe avec les autres — et certes il y a des ponts à couper. Mais parlant aussi du pont suprême qu’est la loi vraie donnée dans la Révélation (« A cette vie, Dieu arracha le juif en jetant jusqu’au ciel le pont de sa Loi »). Du pont encore que celui qui a accueilli la Révélation a à jeter et jette vers le prochain. Du pont même qu’est, pour le savoir, le troisième terme, principe d’une synthèse que Rosenzweig souligne comme non idéaliste puisque venant après deux termes créateurs. Et du pont enfin que le « reste d’Israël » incarne jusqu’à la Rédemption finale(23).
Mais en quoi le pont s’accomplirait-il comme le 1, 2, 3, 4, 5, 6 de notre titre, pont aux cinq piles et aux six arches ? Suivons maintenant, en espérant que nous ne « pontifierons » pas trop, l’analyse du concept de structure.
D’abord la différence. La différence en tant qu’acte de la structure. Pourquoi la structure, forme et en même temps réalité, se donne-t-elle comme différence au sujet fini ? Parce que la forme est elle-même unité et en même temps différence. Parce que l’unité est toujours d’abord faussée par le fini — d’où le formalisme. Et parce que la forme vraie, surgissant dans le réel, ne peut lui apparaître que comme pure différence.
Et cette différence est alors avant tout celle, pour le fini, de l’Autre absolu comme Un primordial. Mais elle ne serait pas différence essentielle si elle n’était pas, à partir de là, différence pure, pour l’Autre absolu, du fini lui-même, supposé lui-même alors Un. D’une unité qui devra certes s’objectiver. Et cela en partant de l’Un primordial qu’est l’Autre absolu. Un primordial que le fini tend d’abord à fausser, à transformer en Un mythique, clos sur soi. Et qu’il doit ensuite reconnaître comme s’ouvrant en fait à lui-même comme nouvel Un. D’où, après le Un, le Deux : 1, 2. Le deuxième terme tendant cependant d’abord à fuir sa propre unité vraie. De sorte que le 1, 2 ne sera que le commencement d’une succession qui devra aller jusqu’à ce que toute la finitude soit enfin objectivement revoulue. Gardons simplement ceci que la structure se donne, dans son acte, comme différence, et qu’apparaissent alors le Un et le Deux.
Mais, de fait, comment le fini se rapporte-t-il d’abord à cette différence à laquelle l’Autre absolu l’appelle à donner toute sa vérité objective ?
Ou bien on reconnaît, le fini reconnaît, à la différence une objectivité, et il ne s’agit plus alors que d’une différence inessentielle, qui ne fait plus éprouver la finitude radicale, et qui n’est plus celle d’un terme absolu. Différence indifférente, abstraite, qui prend place dans l’unité et identité immédiate, anticipative, et en est une expression. Différence qui, comme unité, est forme certes, mais celle du formalisme, excluant le réel imprévisible de l’existence. C’est la différence, certes, selon la métaphysique, mais surtout selon l’empirisme, puisque lui expressément s’en réclame. Une telle différence est celle qui prolifère dans la science positive, le « 1, 2 » se déployant alors jusqu’à l’infini du nombre, sans que jamais aucun Un véritable, faisant éprouver la finitude radicale, et étant structure vraie, consistante, puisse être atteint. Une telle différence, qu’elle soit reconnue comme simplement relative ou qu’elle soit illusoirement absolutisée, est celle qui règne dans le monde social ordinaire. Celle notamment de l’individu individualiste, qui prétend aimer et vouloir sa différence pure, voire celle des autres, mais en fait n’en veut aucune et ne connaît que l’abstraction. Celle finalement aussi, pour le fini ne laissant pas d’éprouver sa finitude radicale, d’un Autre absolu, mais alors faux, clos sur soi, le Dieu mythique, le Dieu obscur.
Ou bien on veut, au nom de l’existence, affirmer une différence pure, essentielle. La même dont nous avons nous-même parlé. Une différence avec laquelle surgirait donc, dans le réel imprévisible, la forme (et structure) vraie. Mais on exclut alors, au nom de la finitude de l’existence, que le fini puisse aller jamais jusqu’à, la reconstituant imprévisiblement, faire reconnaître objectivement pareille forme. Ainsi Heidegger qui, pourtant, proclame, s’opposant à Hegel, que, pour lui, « le propos de la pensée est la différence en tant que différence »(24), et qui dégage alors la « différence de l’être et de l’étant », celle-ci, comme différence pure, étant à la fois, dans la métaphysique, toujours supposée et toujours oubliée, réduite à l’inessentiel. Et de même Lévinas qui pourtant affirme que le Dire « signifie la différence de l’un et de l’autre comme l’un pour l’autre, comme non-indifférence pour l’autre »(25). Ce qu’il précise comme « responsabilité ». Mais cette responsabilité ne va pas, pour lui, jusqu’au savoir philosophique. Avec la conséquence, avec lui comme avec Heidegger, que l’ordre social commun, celui qui ne connaît de différences qu’abstraites, maintient son règne sans partage.
Ensuite l’identité. L’identité comme ce dans quoi s’accomplit la structure. Ne nous expliquons pas ici davantage.
Une telle identité est, par rapport au Deux, d’abord celle du Ternaire, du Trois. Moment de l’identité spéculative. Quand, l’unité originelle s’étant effacée pour son Autre, pour le fini comme son Autre, posé lui-même dans sa différence pure, celui-ci accomplit le même mouvement d’acceptation de la finitude dans la relation à l’Autre, et pose un troisième terme comme étant l’identité reconnue des deux premiers. Moment dont Hegel a définitivement, mais formellement, dégagé la vérité absolue. Mais le fini comme tel, d’une part, ne peut pas, par soi, poser ainsi le troisième terme. Il n’est pas par soi le deuxième terme comme vrai. Il faut que ce mouvement de position d’un troisième terme soit d’abord effectué par l’absolu lui-même devenu, d’Un originel, le Deux, le deuxième terme. D’où le Ternaire comme Ternaire de l’absolu, Trinité. Et le fini comme tel, d’autre part, rejette d’abord la vérité de ce ternaire, le fausse. D’où le Quaternaire, le Quatre, pour autant que le fini aura fait l’épreuve de sa finitude radicale comme rejet de l’absolu et s’établira enfin dans l’identité à lui offerte, de créature. Encore le fini est-il alors simplement supposé avoir revoulu sa finitude tout entière, et donc avoir reconnu au Ternaire absolu toute sa vérité. Simple supposition, de sorte que le Quatre n’est pas forcément le terme ultime.
De ce Quaternaire, celui de l’existence et de l’œuvre où elle se pose, j’ai beaucoup parlé dans La philosophie comme savoir de l’existence. J’y ai notamment beaucoup parlé de la présentation que Heidegger en a faite sous le nom de Geviert, de Quadriparti. Mais Heidegger n’en vient pas d’emblée à ce Quadriparti. De là, selon moi, l’interruption d’Etre et temps à l’issue de la 2° section de la 1° partie, et au moment d’entrer dans la 3° section intitulée « Temps et être ». Pourquoi cette interruption ? Parce que Heidegger s’en tient, dans Etre et temps, au temps comme ternaire, passé, présent, et avenir(26). Et parce que ce n’est que beaucoup plus tard, après sa conférence sur « La chose », qu’il pourra, dans une conférence justement intitulée « Temps et être », reconnaître, au-delà du ternaire initial, une quatrième dimension du temps qui, dit-il, est en fait la première(27). Le temps étant alors, dans l’Ereignis, ce qui le caractérise comme Autre absolu, tandis que l’être est ce par quoi ledit Ereignis se donne à l’homme. A ce quadriparti de « Temps et être », que je présente comme celui de la parole ou du Verbe, j’ai essayé de montrer, aux §§ 13-14-15 du 2° volume, comment s’articulent les autres quadripartis évoqués par Heidegger, et que j’ai présentés, l’un comme celui de la chose ou de l’Incarnation, l’autre enfin et dernier comme celui de l’individu ou de la Passion.
Mais le fini justement refuse d’abord d’aller jusqu’au bout de sa Passion d’individu, où il trouverait son identité essentielle. Qu’est-ce alors pour lui que l’identité ?
Ou bien une identité reconnue objectivement, et alors cette identité peut bien laisser place à de la différence, de l’altérité, de la finitude, elle les rejette comme radicales, elle rejette leur réel imprévisible. Identité de la « bonne forme » selon la Gestalttheorie, à quoi Lacan oppose la structure(28). C’est, plus généralement, l’identité selon la pensée métaphysique, et notamment chez Hegel, lequel peut en venir, pour la philosophie de la nature, à évoquer un quaternaire, mais en reste de toute façon à une identité toujours déjà là. C’est aussi et surtout, en dehors de la philosophie, et de toute théorie, l’identité que se donne le monde social ordinaire, toujours au fond monde mythologique. Identité de ce monde comme système sacrificiel, excluant la différence pure de l’individu et de son œuvre. Un tel monde, Lévi-Strauss lui-même le montre très explicitement structuré par un quaternaire. Mais par le quaternaire de l’analogie, renvoyant toujours à la relation du masculin et du féminin, mais comme relation faussée, devenue « interne », réduite au leurre (dénoncé par Lacan) du « rapport sexuel », de la complémentarité des sexes. Ainsi pour le « mythe d’Œdipe interprété à l’américaine » selon Lévi-Strauss : « La surévaluation de la parenté de sang est, dit-il, à la sousévaluation de celle-ci, comme l’effort pour échapper à l’autochtonie est à l’impossibilité d’y réussir »(29).
Ou bien on veut alors une identité vraie, existante, avec la différence pure, et la finitude radicale. Une identité d’abord en l’Autre absolu, et dont cet Autre donnerait au fini toutes les conditions, celui-ci ayant à son tour à les donner à tout Autre. Une identité qui se constituerait dans l’œuvre, et en traversant une passion. Mais on exclut que cette identité puisse être jamais reconnue objectivement et, même si on en dégage le quaternaire, on ne la montre en rien reconduisant finalement au ternaire absolu. Avec la conséquence de laisser régner l’identité mythologique qui écrase les différences, l’identité de l’analogie. Ainsi Heidegger qui, là où il parle de la différence pure comme Austrag, parle aussi de l’identité primordiale comme Ereignis (« Comment la Différence procède-t-elle de l’essence de l’Identité, demande-t-il ? Le lecteur le découvrira lui-même, s’il écoute l’harmonie qui règne entre l’Ereignis [à quoi « l’essence de l’Identité appartient en propre »] et l’Austrag « (30)). Heidegger qui a bien alors l’idée que l’Ereignis départ son propre à l’homme, son identité — et sa différence pure — de fini. Mais qui exclut toute raison (« En ce domaine, où l’on ne peut rien démontrer, mainte chose peut être montrée, conclut-il »). Et de même Lévinas. Qui ne dit rien, lui, d’une structure quaternaire. Et qui dénonce l’identité mythique de Heidegger. Mais qui s’en tient, lui aussi, au refus de toute raison posée comme telle. Et qui parle ainsi pour le fini, « identifié du dehors », comme créature, de l' »identité injustifiable de l’ipséité »(31).
Enfin la répétition. La répétition comme ce par quoi s’accomplit la structure, et qui la veut. Car comment, pour qui affirme l’identité essentielle, existante, reçue de l’Autre, ne pas se laisser reprendre, d’une manière ou d’une autre, par l’Identité mythologique ? Comment aller jusqu’à faire reconnaître objectivement, jusqu’à « justifier » auprès de tous, l’identité vraie, celle de soi comme individu, mais d’abord celle de l’Autre absolu, de l’Infini, dont il y a, pour Lévinas même, à témoigner ? Ce qui fait obstacle, c’est ce qui est socialement reconnu comme objectif, ce qui vaut socialement comme posé à l’Autre, ce qui est socialement sens. Il faut dès lors, d’une part, montrer ce sens comme étant en fait non-sens, finitude, et d’autre part, pour l’objectivité nouvelle recherchée, revouloir ce non-sens, y donner sens, montrer le sens vrai, tourné vers tout Autre, comme se constituant à partir de là. Or sens et en même temps non-sens définissent la répétition ‑– permettez-moi de renvoyer simplement, à ce propos, au 1° volume de La philosophie comme savoir de l’existence. La répétition est donc bien ce par quoi s’accomplit la structure. Répétition de la différence jusqu’à ce que toute l’épreuve requise de la finitude ait été traversée, jusqu’à l’identité ultime.
La répétition introduit alors, au-delà du quart terme, du Quatre, du Quaternaire, un cinquième terme, le Cinq, le Quinaire. Cinquième terme qui marque la finitude radicale, le non-sens, non pas certes du quatrième terme en soi, mais de ce terme (et, par là, du quaternaire) dans ce qu’il est devenu pour le fini, l’identité de l’analogie. Cinquième terme qui reveut absolument cette finitude radicale, et qui est donc en soi principe absolu, mais qui ne revoudrait pas ainsi cette finitude, s’il ne s’effaçait pas lui-même, comme terme ultime, au profit d’un autre, d’un sixième terme. Le cinquième terme est alors le médiateur. A la fois médiateur pour les relations impliquées dans l’analogie, et qui sont en elles-mêmes contradictions. Et médiateur entre l’absolu vers quoi il dirige, et le quaternaire mythologico-analogique à quoi s’arrête d’abord le fini — et l’analogie trouverait là, enfin, sa vérité.
C’est ce cinquième terme que dégage Lévi-Strauss quand il parle du trickster de la mythologie des Indiens d’Amérique du Nord, et qu’il le présente comme le « médiateur » ou le « messie »(32). Trickster, c’est-à-dire tricheur, celui qui ne joue pas le jeu, qui est à la fois homme et femme, etc. Mais lui-même, Lévi-Strauss, ne dit rien de l’Autre absolu vers quoi dirige ce Messie, et le quinaire qu’il trace alors confirmerait, de la place du sacrifié, le quaternaire mythologique. C’est ce qu’on pourrait opposer, comme objection, à Jean-François Mattéi qui, notamment dans ses ouvrages sur Platon, insiste avec tant de force sur la structure à cinq(33).
C’est ce même cinquième terme que Schelling désigne par la « puissance médiatrice » à l’œuvre dans le paganisme (le monde mythologique) et qui se révélera finalement comme le Christ, Dieu dans la personne du Fils.
Enfin c’est à partir de l’entrée en jeu, pour l’histoire, au-delà du Quaternaire de l’œuvre, de ce cinquième terme (d’où le Quinaire de l’histoire), qu’on pourrait expliquer l’affirmation, non justifiée par Heidegger lui-même, mais en soi décisive, dans le texte « La parole d’Anaximandre », des cinq époques de l’histoire, la grecque, la chrétienne, la moderne, la planétaire, et enfin la vespérale, l’abend-ländische, celle de la terre du soir, l’occidentale(34).
La répétition s’accomplit cependant, nous l’avons dit, par un sixième terme, vers lequel dirige le cinquième, en même temps qu’il fait apparaître dans le quatrième l’Unité absolument originelle. Sixième terme comme répétition ultime, à la fois du monde mythologique et du ternaire absolu, d’abord rendu abstrait et faux. Advient ainsi le Six, le Sénaire — comme double ternaire : la structure par excellence. Donnons à ce propos les quelques références suivantes.
Rosenzweig d’abord. Car ce sénaire, c’est lui qui l’a le premier, pour la philosophie, déployé dans sa nécessité. Sénaire alors de l’Étoile de la Rédemption, constituée de deux ternaires, de deux triangles équilatéraux qui, dit-il, « se chevauchent en se croisant »(35). « Il naît ainsi, poursuit-il, une figure certes construite par la géométrie, mais elle-même étrangère à la géométrie » – une figure comme Gestalt, une « structure achevée et close ». Le premier triangle est celui, abstrait – Dieu, le monde, l’homme – présenté dans la I° partie de l’ouvrage. Le deuxième triangle est celui, concret, historique – Création, Révélation, Rédemption – que propose la 2° partie. Et ces deux triangles ou ternaires sont montrés enfin dans leur articulation d’étoile ou sénaire dès le Seuil qui conclut la 2° partie et introduit à la 3°. Sénaire qui apparaît ultimement comme le visage même de Dieu : « L’Étoile de la Rédemption est devenue visage qui me regarde et à partir duquel je regarde »(36).
Schelling ensuite. Car ce sénaire, on pourrait le voir annoncé dans Schelling, qui fut une lecture, et une référence, majeure de Rosenzweig. Dans l’article qu’il a consacré à l' »architecture de l’Étoile de la Rédemption », Jean-François Marquet disait lui-même de la 1° partie de l’ouvrage qu’on peut « ladéfinir, en termes schellingiens, comme la philosophie négative de Rosenzweig »(37). Ajoutons quant à nous qu’on pourrait établir chez Schelling la distinction suivante. D’abord la philosophie négative, purement rationnelle, avec son ternaire des puissances. Ensuite, après l' »extase de la raison », la philosophie positive, historique, avec son ternaire des personnes – quand les puissances adviennent comme personnes divines, mais à travers l’épreuve de la mythologie où ces personnes ne sont toujours vues, par les hommes, que comme des puissances, jusqu’à la Révélation où elles apparaissent enfin en elles-mêmes, comme Père, Fils et Esprit.
Hegel maintenant. Car ce sénaire, on pourrait même le retrouver chez Hegel, contre lequel Schelling avance sa distinction de la philosophie négative et de la philosophie positive, son « extase de la raison », son affirmation déjà de l’existence. Et chez Hegel, précisément dans La Phénoménologie de l’Esprit. Dont la structure fait problème (cf. les titres des ouvrages de J. Hyppolite et P.-J. Labarrière(38)). Et qui pourrait être présentée selon deux ternaires. Le ternaire d’abord des cinq premiers chapitres, déjà rangés en trois temps par Hegel lui-même (conscience, les trois premiers chapitres ; conscience de soi ; raison), les trois mêmes temps qui seront ceux de la section « phénoménologie de l’esprit » dans l’Encyclopédie. Le ternaire ensuite des trois derniers chapitres, ternaire concret, historique constituant une 2° partie (esprit ; religion ; savoir absolu), 2° partie que Hegel aurait, selon Th. Haering cité par Hyppolite, ajoutée au dernier moment. Mais certes Hegel ne dit rien d’un tel sénaire, et finalement le dissout dans le ternaire absolu partout déployé.
Enfin, sans parler même de Descartes et des six parties du Discours de la méthode, des six Méditations, des six passions primitives (deux fois trois), Heidegger lui-même. Car le sénaire apparaît très clairement, certes sans être reconnu comme tel, dans Etre et temps. D’abord dans le plan général de l’ouvrage annoncé au § 8 : deux parties, avec trois sections chacune – et Heidegger dit lui-même, de la 2° partie où s’accomplit la « destruction de la tradition ontologique », que c’est là que « la question de l’être trouve sa concrétion véritable [ihre wahrhafte Konkretion ] »(39). Puis dans le plan de chacune des deux sections publiées de la 1° partie, avec six chapitres à chaque fois, pour lesquels on pourrait montrer la même structure doublement ternaire. Je n’en dis pas plus.
Je considère que le sénaire 1, 2, 3, 4, 5, 6 a été suffisamment établi. J’aurais voulu conclure en montrant — je vais le faire brièvement — comment la structure ainsi présentée dans son concept peut s’accomplir effectivement. La structure non plus dans son concept, mais dans sa réalité. Laquelle est d’abord l’échec de l’accomplissement, et ne peut passer outre à cet échec que parce que l’Autre absolu se révèle dans sa vérité sénaire primordiale. Ainsi pour le visage de Dieu. Mais aussi pour la création du monde en six jours ; création au dernier jour de laquelle, après avoir créé l’homme à son image, Dieu est dit avoir trouvé cela, non pas simplement « bon », comme les autres jours, mais « très bon » ; création dont l’acte devra être, à tous les niveaux, répété. Et cette révélation conduira finalement jusqu’au savoir (« S’il tourne vers nous sa face, dit Rosenzweig, c’est que nous pouvons le connaître »(40)).
J’aurais parlé de la Révélation chrétienne qui permet seule d’établir socialement le monde historique voulu par la philosophie, et où chacun pourrait reconstituer, dans son œuvre propre, la structure, et accéder au savoir. De la Révélation juive, révélation originelle qui doit être reconnue comme vérité suprême par ce monde, si celui-ci veut s’accomplir. De la Révélation islamique enfin, qui doit à son tour être proclamée, si le savoir alors atteint doit pouvoir se poser comme reconnu par tous, fût-ce de manière simplement implicite.
J’aurais donc parlé, après le ternaire de la structure dans son concept — différence, identité, répétition —, du ternaire de la structure dans sa réalité : désespoir, rédemption, superstition.
J’aurais parlé du désespoir, dont l’histoire approfondit sans cesse l’épreuve, et qu’il faudra cependant revouloir. Ce désespoir n’est autre, annoncé par Kierkegaard qui parle de « mourir se [changeant] continuellement en vivre », d' »accumulation d’être », d' »autodestruction impuissante »(41), que ce qui apparaîtra avec la psychanalyse comme pulsion de mort. J’aurais à ce propos cité Lacan concluant ainsi son séminaire sur le Moi : « C’est ici que nous débouchons sur l’ordre symbolique, qui n’est pas l’ordre libidinal où s’inscrivent aussi bien le moi que toutes les pulsions. Il tend au-delà du principe de plaisir, hors des limites de la vie, et c’est pourquoi Freud l’identifie à l’instinct de mort »(42). Et Lacan précise : « L’instinct de mort n’est que le masque de l’ordre symbolique, en tant — Freud l’écrit — qu’il est muet, c’est-à-dire en tant qu’il ne s’est pas réalisé. Tant que la reconnaissance symbolique ne s’est pas établie, par définition, l’ordre symbolique est muet. L’ordre symbolique à la fois non-étant et insistant pour être, voilà ce que Freud vise quand il nous parle de l’instinct de mort comme ce qu’il y a de plus fondamental — un ordre symbolique en gésine, en train de venir, insistant pour être réalisé ».
J’aurais parlé de la rédemption, que permet suprêmement, parmi les hommes, le peuple messianique, le peuple éternel, quand le fond du désespoir a été touché.
J’aurais parlé pour finir de la superstition, de la superstition absolument positive qui n’est autre que le savoir absolu que veut la philosophie, et où l’absolu pourra enfin, sans falsification, être trouvé en chaque élément, ce qui permettra une véritable communauté spirituelle, celle que proclame à sa manière la Révélation islamique. Quand l’ordre symbolique aura été réalisé. Quand ce qui était masque sera devenu visage. Quand ce qui était muet sera devenu parlant (c’est, pour Lacan, le symbolique comme « ex-sistence du dire »(43)). Quand ce qui se manifestait comme revenant, l’Unheimliche, l’inquiétante étrangeté, aura été accueilli et élevé à sa vérité par les superstites, par les survivants, par les témoins. Donnons à nouveau, pour terminer, la parole à Rosenzweig : « Dans les deux triangles superposés, l’Étoile reflétait ses éléments et la composition de ses éléments de manière à en faire une voie unique ; de même, les organes du visage se partagent en deux niveaux… Le premier triangle élémentaire est formé par le milieu du front, point dominant de tout le visage, et par le milieu des joues ; sur lui se superpose un second triangle composé par les organes dont le jeu donne vie au masque figé du premier : les yeux et la bouche »(44). Entre le 6 de Dieu et le 666 du diable, l’homme si, par son savoir, il reconstitue lui-même ce visage, aura alors, jetant les dés, tenté, et obtenu, son double 6.