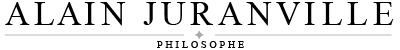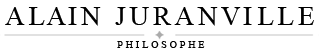Que résulte-t-il, pour la philosophie, de l’importance majeure donnée aujourd’hui à l’interprétation ? Pour la pensée métaphysique, de Platon jusqu’à Hegel, l’interprétation doit être laissée à la religion, et remplacée par l’explication scientifique, éminemment dans la forme du savoir absolu de la philosophie. Mais la pensée contemporaine met au contraire au premier plan l’interprétation, récusant l’idée même du savoir philosophique. Qu’en est-il avec la psychanalyse ?
Je définirai la pensée contemporaine comme pensée de l’existence.
Contre la réduction de la vérité partielle de l’existence dans la finalisme du savoir, elle affirme la vérité ontologique indépassable de l’existence, comme surgissement au-delà de toute anticipation, temps positif où le sens se constitue, création. Ainsi pour l’être de Heidegger.
L’interprétation, avec son essentielle diversité, apparaît alors comme le rapport positif par excellence à l’existence, la réalité de l’éthique. Non pas tentative de se défaire du non-sens et de dégager un sens toujours déjà là, mais donation d’un sens nouveau, avec le non-sens même. Non pas idéalisation, mais ce qu’on appelle avec la psychanalyse la sublimation. Mais cette sublimation est finie et implique le maintien d’une idéalisation — l’interprétation donne sens nouveau, mais à quelque choser qu’elle suppose plein de sens.
Dans ces conditions, l’homme est voué à l’hétéronomie. L’idéal de sublimation infinie au-delà de toutes possibilités humaines lui apparaît comme l’Autre absolu, lieu du sacré et du religieux, et l’existence effective devient relation essentielle à cet Autre absent. Mais, en même temps, la finitude fait qu’il ne peut qu’incarner cet Autre dans un maître et voir, dans l’interprétation déjà effectuée du maître, à la fois, ce qui l’appelle à renoncer à l’illusion de possession de soi et à entrer dans la sublimation, le modèle de son propre travail d’interprétation, et la loi même de l’Autre absolu. L’accès à la sublimation et au savoir requiert alors le sacrifice, tant pour l’individu que pour le groupe dans son ensemble
Et l’on comprend finalement que le savoir philosophique doive être exclu, comme principe et comme visée bien sûr, puisque la recherche du savoir est fuite devant la vérité de l’existence, mais aussi comme effet, la raison refusant toute loi qu’elle ne serait pas elle-même donnée.
Qu’apporte à cela la psychanalyse ? Comment caractériser ce qu’on peut appeler la « pensée de l’inconscient » ?
Contre l’idée d’une maîtrise de l’inconscient par le psychanalyste et, grâce à la cure, par le patient — et une certaine présentation de Freud pourrait y conduire —, Lacan a souligné que l’hypothèse de l’inconscient doit être située dans le mouvement de la pensée de l’existence attachée à la critique de la métaphysique. D’où la détermination de l’inconscient comme l’Autre du langage. Il semblerait alors que l’inconscient retrouvât l’hétéronomie de la pensée de l’existence.
Mais l’interprétation avec l’inconscient est aussi grâce de l’interprétation. Car l’hypothèse de l’inconscient est avancée dans une relation thérapeutique. Et, pour libérer le patient de la fascination, il ne suffit pas de dire, dans l’interprétation, que nul n’est l’Autre absolu — la finitude reste et l’incarnation de l’Autre dans un maître —, il faut, là on incarne suprêmement cet Autre, renoncer à l’image fascinante de l’interprétation, témoigner par son être de l’absence de l’Autre, se faire pour l’autre présent l’objet que Lacan appelle objet « a », lieu de non-signifiance, déchet. Telle est la grâce de l’interprétation. « La mesure dans laquelle le christianisme nous intéresse, j’entends au niveau de la théorie, dit ainsi Lacan, se résume précisément au rôle donné à la grâce. Qui ne voit que la grâce a le rapport le plus étroit avec ce que moi, partant de fonctions théoriques qui n’ont certes rien à faire avec les effusions du cœur, je désigne comme le désir de l’Autre ? ». Mais, si la sublimation impliquée par l’interprétation était et demeure finie, la grâce de l’interprétation veut une sublimation totale, par quoi on puisse, dans une absolue liberté — accomplissement de l’éthique au-delà de l’affrontement à l’immaîtrisable —, revouloir l’inéluctable finitude, la donner à l’autre présent dans l’acte même de la grâce.
Dès lors, on est conduit à passer outre à l’hétéronomie et à affirmer l’autonomie. L’inconscient n’est plus l’Autre absolu qui, de l’extérieur, inflige au sujet la loi du désir, mais la Chose, cœur le plus intérieur du sujet, qui pose elle-même l’Autre de la loi à laquelle elle s’assujettit en ex-sistant — souffrance certes, mais non pas violence. Et l’accès à la sublimation n’est plus sacrifice, mais grâce reçue et rendue, revouloir libre du destin de finitude inscrit dans l’objet, par quoi peut enfin passer, et déjà dans l’initiation, l’objectivité du savoir.
On doit alors reconsidérer le problème du savoir philosophique. Car, avec l’autonomie, place est à nouveau donnée à la raison. Et le problème du savoir philosophique, de l’onto-logie, d’une ontologie non métaphysique, mais réel savoir absolu comme effet, revient à se demander si la même grâce qu’on avait rencontrée avec l’interprétation psychanalytique peut se retrouver avec la philosophie, assurant à la raison pure son objectivité.
Je voudrais montrer maintenant :
-
ce qu’il en est de la psychanalyse, en quoi elle est conduite, pour accomplir son acte, à faire la grâce d’elle-même — grâce que cependant elle doit avoir reçue de la philosophie (disons : la psychanalyse à la grâce de la philosophie) ;
-
ce qu’il en est à son tour de la philosophie comme interprétation qui, elle aussi, ne peut accomplir son acte que par la grâce qu’elle fait d’elle-même, au monde social, grâce reçue cependant des religions révélées (disons alors : la philosophie à la grâce de Dieu).
L’interprétation psychanalytique est marquée par une contradiction fondamentale, entre, d’une part, sa visée, qui est disparition du symptôme et, d’autre part, le fait de l’interprétation, qui fixe au contraire le patient à son symptôme. Cette contradiction apparaît sur le plan de sa nature même, et s’y résout en tant que contradiction logique. Mais elle est en réalité contradiction éthique, qui ne peut être levée que par la grâce de l’interprétation.
La nature de l’interprétation psychanalytique. Elle est d’abord idée, qui introduit la contradiction. Elle est ensuite œuvre, où celle-ci est résolue, du moins comme logique.
L’idée de l’interprétation est le concept de l’inconscient. Si la visée ou forme de la psychanalyse est thérapeutique, sa réalité est éthique, affrontement à l’inanticipable. Lacan l’a souligné, et il faut en tirer toutes les conséquences.
Freud a certes désigné de façon définitive les phénomènes de l’inconscient en supposant, au principe des symptômes névrotiques, d’autres processus de pensée que ceux de la conscience et en voyant dans les associations libres de la cure la reprise de ces mêmes processus. Mais il conçoit le langage comme conscience, et la parole de la cure est pour lui tentative pour exprimer dans le langage des pensées inconscientes, en soi hors langage, pour les faire revenir à la conscience. De sorte que la visée de maîtrise par la conscience n’est nullement remise en question. L’hypothèse de l’inconscient n’a rien d’éthique, n’est qu’une hypothèse de la science, et précisément de la science empirique, qui doit être vérifiée expérimentalement.
Lacan reprend l’hypothèse freudienne et, contre la preuve expérimentale, contestée, propose une preuve logique, a priori. Il s’appuie d’abord sur la linguistique structurale, et sa conception du langage comme pur jeu de la différence symbolique. Plus essentiellement il retrouve la pensée de l’existence, en particulier Heidegger, l’inconscient ne pouvant être proprement pensé que comme vérité ontologique du signifiant produisant le signifié. Mais alors l’inconscient, tout comme l’existence, ne saurait être une hypothèse de la science. Si l’inconscient est vérité ontologique, c’est une vérité ontologique immaîtrisable dans un savoir, fût-ce une ontologie, et qui ne peut être introduite, bien sûr déjà dans le cas de Freud, que par un acte éthique. « Le statut de l’inconscient est éthique », dit ainsi Lacan. Simplement l’éthique à quoi conduit l’inconscient ne peut être à ce stade qu’affrontement avec la loi fondamentale de l’interdit, et plus radicalement avec son fond cruel comme loi de la jouissance (c’est ce que montre Lacan dans « Kant avec Sade »).
Si cependant on s’attache au statut éthique de l’inconscient et considère le mouvement effectif de l’éthique dans la cure, apparaît que le Bien suprême est d’abord, pour le sujet, non pas la loi, mais l’objet incestueux qu’elle interdit, que Lacan appelle la Chose. L’éthique est alors de transgresser l’interdit pour aller vers ce Bien, et ce qu’on trouve, au-delà de l’illusion de plénitude et de signifiance pure qu’entretiennent l’interdit et la rivalité œdipienne, c’est vérité certes, mais mêlée de non-vérité, désir et pulsion de mort, le réel du désir de l’homme. Simplement cette vérité partielle du désir est rencontrée par le sujet dans le mouvement de l’éthique, lorsqu’il a passé outre à la haine et à l’accusation de l’autre. Il ne peut donc plus éprouver la loi du désir comme venant de quelque Autre absolu, mais découvre que c’est lui-même qui se l’inflige, s’ouvrant à l’Autre absolu qu’il fait lieu de la loi. La vérité partielle du désir où la Chose s’écartèle, c’est la vérité totale de la Chose elle-même, dans sa jouissance absolue, qui la pose — signifiance pure comme réelle. C’est ce qui chez Lacan même se marque dans la théorie ultime du nœud borroméen.
L’œuvre de l’interprétation psychanalytique est alors l’intervention, qui peut seule lever la contradiction logique qu’il y a entre la réalité éthique impliquée par l’inconscient et la forme thérapeutique, et permettre de poser la vérité de l’inconscient sans le contredire, en lui donnant valeur aux yeux de l’autre.
Disons d’abord que l’interprétation par l’inconscient a de l’effet sur le patient. L’interprétation en général s’adresse au sujet, est position du désir au sujet. Distinguons ce qui est à interpréter, et qu’on suppose plein de sens — c’est la Chose ; ce que dégage le travail de l’interprétation, le sens — c’est la loi de l’Autre ; ce qui interprète — c’est l’objet, « truchement », déchet de l’interprétation ; celui enfin à qui on interprète — c’est le sujet, celui qui a à s’assujettir à la loi, le patient en l’occurrence. Position donc du quaternaire du désir. Et le sujet est atteint effectivement parce que l’interprétation est métaphore, l’acte même du désir, institution du sujet de l’inconscient — car interpréter n’est pas expliquer, la Chose en question n’est rien en dehors de l’interprète qui, objet certes, mais aussi et d’abord Chose, interprète en inventant. L’interprétation psychanalytique l’emporte alors sur l’interprétation névrotique liée au symptôme, parce qu’elle est l’interprétation par excellence, celle qui fait du passage du manifeste au caché, par l’équivoque notamment, l’être même de son objet. Wittgenstein note, contre Freud, que c’est le genre d’interprétation qu’on est enclin à approuver, qui séduit. « Une mythologie d’un grand pouvoir », conclut-il.
On peut se demander comment cet effet peut correspondre à ce que vise la psychanalyse. Car l’oracle aussi pose un sens par un acte métaphorique, énonce une signification en se produisant comme signifiance. « Le maître dont l’oracle est à Delphes, ne dit ni ne cache, mais signifie », dit Héraclite. L’oracle est maîtrise, ce que récuse la psychanalyse et qui contredit l’inconscient. Ce ne sera pas en fuyant la signification par l’équivoque que l’interprétation psychanalytique pourra alors se distinguer de l’oracle. Équivoque, il l’est suprêmement, requérant toujours des prêtres pour rendre clair ce qu’il énonce. Ce qui caractérise l’interprétation psychanalytique, c’est son intention, qui laisse être l’« inconscient » ; la valeur absolue qu’elle donne à la parole, à la signification nouvelle qui vient en l’autre ; son refus de conclure. Si une conclusion doit être tirée, c’est au patient de le faire, le moment venu. L’oracle au contraire est signifiance ultime qui clôt la parole et dont on ne sort plus.
Comment l’interprétation psychanalytique peut-elle satisfaire à cette exigence ? Il lui faut être significative, énoncer sans équivoque la loi à quoi le patient est assujetti et qui le fait objet et, en même temps, laisser revenir la parole, permettre que le sujet sorte de l’évanouissement du désir dans l’objet. « L’interprétation n’est pas ouverte à tous les sens, dit Lacan. Elle n’est point n’importe laquelle. Elle est une interprétation significative, et qui ne doit pas être manquée ». Et, en même temps, « elle renverse le rapport qui fait que le signifiant a pour effet, dans le langage, le signifié. Elle a pour effet de faire surgir un signifiant irréductible ». Mais c’est le fantasme, support du signifié, qui implique disparition et présence du désir, alternance d’objet et de sujet, d’être et de pensée. Et l’interprétation est finalement mise en acte du fantasme, re-dire, re-position du même signifié que le patient ne cesse de dire, lui montrant simplement que, là même où l’interprétation le fait objet, le désir reviendra selon l’alternance du fantasme. Telle est l’intervention, qui ne clôt rien, et qui n’est possible, au-delà même de la cure, dans les affaires publiques ou l’existence privée, que si on est entré dans le fantasme et dans le dire de l’autre et ne fait au plus — mais là est tout — que le mettre en acte.
La grâce de l’interprétation psychanalytique maintenant. Elle est d’abord condition, qui est d’assumer la contradiction comme indépassable. Elle est ensuite cause, par quoi, de l’extérieur, la contradiction est posée — et résolue.
La condition de l’interprétation psychanalytique est le transfert. Idée commune, mais qu’il faut bien peser. Sans le transfert, le sujet est voué à se livrer à la violence de l’être fascinant. Et c’est l’éthique, dont le principe est la réquisition par l’autre de ne pas exercer de violence, qui veut que le transfert soit suscité. Dépassement de l’éthique « idéaliste », de l’affrontement solitaire à l’immaîtrisable, vers une éthique « réaliste », par quoi on donne à l’autre sa propre « dénucléation » par lui comme Autre absolu incarné, sa propre « obsession par le prochain », dit Lévinas, son propre transfert qui, seul, peut libérer le transfert en l’autre. En ce sens, le transfert est grâce.
Précisons d’abord en quoi il faut introduire le transfert. L’interprétation par l’inconscient a beau valoir pour le patient, encore faut-il, pour qu’il se délivre du symptôme, qu’il entre à son tour dans la sublimation et rompe avec la jouissance mortifère dans laquelle il est pris. Mais la finitude est irréductible, et on ne put échapper à la pulsion de mort. Dans ces conditions, ou bien on s’en tient à la fascination, qui est, en même temps, idéalisation de l’autre qui a sublimé et donne son désir, et abjection de soi par quoi on s’offre comme objet, victime, dépôt de la finitude — et alors on peut fuir la confrontation au désir et préserver le symptôme. Ou bien on accède au transfert, qui reste idéalisation de l’autre, mais qui est en même temps sublimation, don en retour de son propre désir à l’autre qui, outre l’idéalisation, accepte d’en être l’objet-déchet. Le transfert n’a rien de négatif. Il n’a pas à être « liquidé », mais suscité et assumé. Fini, l’homme ne peut qu’incarner en un autre présent l’Autre absolu, et le transfert est alors le rapport immédiat le plus positif à cet autre présent. Si dépassement de la finitude il doit y avoir, ce ne peut être, par rapport à l’autre présent, que revouloir de cette finitude, don de son propre transfert.
Et c’est ainsi que s’effectue l’introduction du transfert dans la cure. Le psychanalyste s’offre comme objet. Au-delà de la position de l’interprétation, qui est valeur fascinante, il donne sa dé-position de soi, affirme sa non-valeur. Pour Lacan, comme le saint, il « fait le déchet ». Mais c’est pour laisser advenir le désir et la sublimation en l’autre, qu’il pose comme « toute-valeur ». Et il n’y a là nul masochisme, nul renversement pur de la fascination, ce qui détournerait le patient d’un travail effectif de sublimation. Si Lacan peut dire que « son désir lui permet [à lui, l’analyste], dans une hypnose à l’envers, d’incarner, lui, l’hypnotisé », on doit souligner que l’analyste est objet, mais « affecté d’un désir » dans la relation à l’autre présent. S’offrant comme objet, il donne en fait son propre transfert, impliqué dans l’interprétation — car interpréter n’est pas créer, c’est supposer, dans ce à quoi on va donner un sens nouveau, présence déjà d’une plénitude de sens. Et c’est cela qui distingue l’analyste du maître. Celui-ci aussi transfère sur l’autre présent, et c’est par là qu’il peut sublimer et donner interprétation, mais il garde pour lui son transfert. Éminemment dans le sacrifice ; autrement déjà dans la domination, où il se laisse bien comme objet-déchet à l’inférieur, mais sans se poser comme tel ; tout autrement sans doute dans l’initiation, où il se pose certes comme déchet pour l’autre, mais dans la visée de leur commune maîtrise et valeur. Là même où il transmet, le maître ne transmet pas à l’autre son propre transfert sur lui comme absolu, l’intransmissible, pure restitution, que seul l’analyste justement peut transmettre.
Qu’est-ce qui permet dès lors que soit transmis le transfert ? Bien sûr d’abord l’acte éthique de l’analyste qui, au-delà de son œuvre, donne encore, selon le mot de Blanchot, son désœuvrement, sa finitude, c’est-à-dire son transfert. On dépasse alors l’éthique « idéaliste », à quoi s’en tiennent bien des formulations de Lacan, pour une éthique « réaliste » qui, d’une part, retrouve la conception de Lévinas d’une « responsabilité pour autrui », d’autre part, contre Lévinas, introduit, par l’autonomie qu’implique l’inconscient, à une vraie responsabilité qui ne soit pas culpabilité, et où on reveuille librement, pour le Bien, le mal présent dans la finitude. Mais cet acte éthique laisse place pour le patient à l’épreuve et à la libre reprise par lui de la vérité de l’inconscient. Il lui fait apparaître comme savoir objectif — et précisément savoir de la vérité — ce que dit l’analyste (d’où le « sujet supposé savoir » de Lacan : on suppose le savoir à qui, ayant sublimé, donne encore son être d’objet). Dans ces conditions, ce qui permet la transmission du transfert (et porte en lui l’acte éthique), c’est le discours du psychanalyste par quoi il énonce socialement l’inconscient. Je ferai simplement référence à la célèbre théorie lacanienne des quatre discours. Resterait à se demander ce qui, dans le discours psychanalytique lui-même, fait qu’il peut apparaître comme tenu de la place de l’objet, comme lieu d’un savoir objectif, et susciter le transfert.
La cause de l’interprétation psychanalytique est la raison. Paradoxe sans doute. Car le psychanalyste ne doit pas se donner comme la raison incarnée, celui qui a réponse à tout et qui est maître de sa parole — et c’est pour cela qu’il peut apparaître lieu d’un savoir objectif et suscite le transfert. Alors que la philosophie se donne bien comme raison pure — mais ne passe pas comme savoir à celui qui interroge. Reste que la psychanalyse est un discours disant l’inconscient, et qu’on ne peut dire cela et pas autre chose que par la raison, et finalement dans la philosophie. Montrons que cela implique simplement que la psychanalyse, raison en soi, a besoin de la grâce venue de la raison pour soi de la philosophie.
Seule la raison peut susciter le transfert. Un savoir qui n’est justifié que par l’autorité de la parole est un savoir qui ne passe pas. Le maître ne suscite pas le transfert, mais la fascination. Il n’est pas supposé savoir, mais désirer. La justification par la raison permet au contraire, dans le dialogue, qu’objet et sujet passent de l’un à l’autre, celui qui demande raison réadvenant comme sujet, celui qui doit rendre raison se retrouvant fait objet, chacun étant pour l’autre le lieu de la raison, incarnation de l’Autre absolu. Présence, par conséquent, de tous les éléments du transfert. Qu’on n’aille pas dire que la raison contredit l’inconscient. L’inconscient certes est l’imprévisible, le sans-raison de la parole. Mais la position de l’inconscient n’est pas simplement parole, mais aussi pensée, dont l’essence est la raison. De Freud, Lacan disait ainsi : « Sa pensée mérite d’être qualifiée, au plus haut degré, et de la façon la plus ferme, de rationaliste au sens plein du terme, et de bout en bout. Je ne crois pas qu’il y ait chez lui aucune abdication, prosternation finale, qu’il renonce jamais à opérer avec la raison », et encore : « L’instinct de mort, ce n’est pas un aveu d’impuissance, ce n’est pas l’arrêt devant un irréductible, un ineffable dernier, c’est un concept ».
Pour ce qui est alors du discours psychanalytique, sans doute doit-il faire advenir son autre à l’épreuve du non-sens, du réel dans le désir. C’est par cela qu’il se distingue d’abord des autres discours, qui entretiennent l’illusion, propre au discours, d’un monde comme totalité et complémentarité. « Arriverai-je à vous dire ce qui s’appellerait un bout de réel ? », demande Lacan. Mais ce réel, ce non-sens, il ne peut le dire que par le sens, que par son absolue consistance qu’il oppose à la consistance partielle des autres discours. Contre l’« effet de fascination » des autres discours, Lacan avance l’« effet de sens » du discours analytique, dont il précise qu’il n’est pas imaginaire, ni symbolique, mais réel. Simplement le discours psychanalytique ne peut pas poser socialement sa raison comme telle, sans perdre sa capacité de faire acte pour le patient. Sa raison même veut qu’il la taise, se fasse objet. Telle est sa grâce, dispensée à l’individu.
Il faut cependant un discours qui justifie pour le monde social le discours psychanalytique, établisse comme telle sa raison — sans quoi le transfert du patient, qui est d’abord un être social, de discours, avant d’être un individu, demeure impossible. Et ce discours ne peut être que celui de la philosophie. D’où la référence nécessaire à la philosophie de la psychanalyse, mais aussi du psychanalyste, toujours guetté par l’imposture. Précisément transfert de la psychanalyse sur la philosophie, qui se marque dans son discours par la conjonction de références aux analyses de la philosophie et de récusations permanentes à leurs perspectives — il faut bien que le discours psychanalytique reste le discours qu’il est. Mais tout cela n’est possible que si la philosophie elle-même veut son propre effacement, fait grâce à la psychanalyse de la justification qu’elle lui apporte. C’est ce qu’il s’agit d’examiner maintenant.
L’interprétation philosophique, comme l’interprétation psychanalytique, est elle aussi marquée par une contradiction fondamentale, entre, d’une part, sa visée, qui est la disparition du phénomène social du sacrifice, impliquant l’injustice et, d’autre part, le fait de son surgissement comme intégrale qui entretient la croyance en la toute-puissance humaine et perpétue le sacrifice. Comme pour la psychanalyse, cette contradiction apparaît sur le plan même de la nature de l’interprétation philosophique, et s’y résout alors en tant que contradiction logique. Mais elle aussi est en réalité contradiction éthique, qui ne peut être levée que par la grâce de l’interprétation, ici communication de sa foi et attente de la révélation.
La nature de l’interprétation philosophique. Elle est d’abord idée, ensuite œuvre.
L’idée de l’interprétation philosophique est le concept de l’histoire. Si sa réalité est bien logique (elle se veut et se fait discours total), la philosophique a également une visée ou forme, qui est politique, et qui introduit une mise en question de la totalité.
La philosophie se donne d’abord dans sa réalité logique de discours et de savoir. Elle apparaît comme questionnement qui certes met en cause à l’avance toute réponse, mais qui vise le savoir comme « le bien ». Sans doute se précise-t-elle, Heidegger l’a montré, comme question de l’être — ce qui implique passage au-delà de l’évidence du monde et du savoir ordinaires. Mais, plus essentiellement, dans le champ de discours ouvert par la question de l’être, et contre les discours métaphysique et empiriste qui s’attachent chacun à un seul des deux aspects contradictoires de la question, elle est ce discours particulier qui assume l’un et l’autre, affirme, à la fois, une vérité totale (c’est l’objet du questionnement) et une vérité simplement partielle (c’est ce qui assure valeur absolue au fait de la question). Au-delà de la mise en question par l’être de l’évidence du savoir ordinaire, elle est alors savoir retrouvé, savoir de l’être, ontologie.
Mais il y a un monde social qui ne laisse pas de place au doute et à la question, et où la philosophie est impossible. C’est celui que j’appellerai le monde traditionnel. Il se présente comme totalité harmonieuse où chacun sait à l’avance, en fonction de son statut, ce qu’il a à faire dans telle ou telle situation, où l’incertitude propre au monde moderne est ignorée. Et sans doute le savoir qui y est transmis est-il savoir réel, produit d’une effective sublimation et formation spirituelle que la société impose à chacun, par exemple dans l’initiation. Mais, pour la pensée contemporaine, l’idée de totalité exclusive est une illusion, fondée socialement sur le rapport de fascination, lequel se répète à travers toutes les hiérarchies du monde social, et renvoie finalement à la complémentarité illusoire du fantasme. Ce qui fixe le rapport de fascination, c’est alors le sacrifice par lequel un seul, hors droit — c’est la victime —, est chargé par la communauté du faix de finitude, objet pur la soutenant comme, elle, sujet qui sait.
Le monde où la philosophie est possible est celui qu’on peut appeler le monde historique. Il est ouvert par l’apparition, dans le monde social, du discours psychanalytique, qui ébranle l’évidence du discours et de la totalité à quoi s’en tiennent les autres discours, et qui incarne socialement la question. Le discours psychanalytique libère chacun de l’obligation de participer à la jouissance communautaire, déploie pour lui l’espace du droit, permet que soit levée effectivement la fascination. Et la philosophie est alors le discours qui, savoir de la vérité par son rapport au discours psychanalytique, justifie la rupture qu’il constitue, pose la loi absolument juste et établit le monde historique. La rupture de l’historie n’apparaissant pas d’emblée comme discours psychanalytique, l’histoire se caractérise finalement par ses époques et par le mouvement de détraditionalisation qui s’y déploie, d’établissement de l’État de droit de la démocratie.
L’œuvre de l’interprétation philosophique est alors l’institution qui, seule, peut lever la contradiction logique entre la visée politique de la philosophie et sa réalité logique de discours, et qui permet de poser la justice de l’histoire sans se contredire, d’établir socialement la puissance de la justice.
Soulignons d’emblée que l’interprétation philosophique a, en tant que discours, de l’effet sur le monde social. Le discours philosophique n’a certes pas de pouvoir réel, ne fait pas apparaître à l’autre la vérité de ce qu’il énonce, et il est alors reçu socialement comme discours clérical, ou encore universitaire. Seul a un pouvoir réel, parmi les quatre discours, le discours psychanalytique, volonté générale qui parle en chacun, mais qui ne peut se poser comme telle, exercer politiquement son pouvoir. Mais, comme le discours du maître, où s’exprime le discours métaphysique, le discours philosophico-clérical exerce un pouvoir formel, assujettit l’autre à l’idée toute formelle qu’il y a de la vérité dans ce qu’il énonce — là dans le caractère suffisant de la sublimation traditionnelle et la validité de la loi positive, ici dans l’idéal d’une sublimation totale et d’une justice absolue. Et ce qui caractérise finalement l’histoire, c’est la victoire du discours philosophico-clérical ou révolutionnaire sur le discours magistral ou traditionnel, pour Nietzsche de l’aristocratie sacerdotale sur l’aristocratie guerrière. Eternelle séduction des prêtres. Corruption de la jeunesse par les philosophes.
Mais cette victoire et cet effet correspondent-ils à ce que vise la philosophie ? L’idéologie aussi pose l’idéal d’une absolue justice. Elle est pur discours clérical qui exerce sans partage son pouvoir de discours et veut introduire socialement la loi juste qu’il exalte, valeur suprême qui n’est cependant que formellement juste. Elle conduit alors au totalitarisme, à la terreur et à l’extermination. Et ce ne sera pas par la raison que la philosophie pourra se distinguer de l’idéologie. Car, avec la pensée contemporaine, il ne saurait y avoir de raison comme principe. La raison est forme, que l’idéologie possède tout autant que la philosophie. Ce qui distingue la philosophie de l’idéologie, comme l’interprétation psychanalytique se distinguait de l’oracle, c’est d’abord, au niveau du discours clérical où elle s’exprime, son intention, qui est d’établir la justice de l’histoire et de rejeter le sacrifice ; la valeur absolue qu’elle donne à la question ; son refus d’exclure. Et c’est ce qui se marque dans la différence de leurs principes : d’une part, le mythe fondamental de l’idéologie, qui reste valeur et rejette la question ; d’autre part, le principe de la philosophie, qui est, en fait, essence de l’être, unité d’un ternaire logique, pris dans le langage même, et qui permet des analyses structurales, et laisse place à la question.
Comment l’interprétation philosophique peut-elle résoudre la contradiction qui résulte de son pouvoir de discours et satisfaire aux exigences qui sont les siennes ? Il faut, à la fois, que la loi absolument juste soit énoncée effectivement, avec le droit à la question, et qu’elle reçoive l’évidence sociale que la philosophie en tant que discours clérical ne peut lui donner. Mais cette conjonction de mise en question d’une part et d’évidence d’autre part caractérise justement le conflit essentiel de l’histoire, entre discours clérical et discours magistral, discours révolutionnaire et discours traditionnel. L’œuvre de l’interprétation philosophique est dans ces conditions mise en acte du conflit, revouloir de l’opposition des deux discours, ce qui implique reconnaissance, par la philosophie, de l’autre pouvoir avec lequel elle voulait rompre. Telle est l’institution où, à l’autorité qui vient du discours traditionnel s’allie la légitimité que seule peut assurer la philosophie — ainsi, sur le plan de l’État, avec l’équilibre des pouvoirs, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Puissance est alors donnée à la justice.
La grâce de l’interprétation philosophique maintenant. D’abord comme condition, et enfin comme cause.
La condition de l’interprétation philosophique est la foi. Paradoxe si la philosophie est, dans sa réalité, logique. Mais, sans la foi, le monde social est voué à l’abdication de la raison devant les prestiges de la superstition et à la perpétration du sacrifice. C’est la logique même, dont le principe est le désir d’obtenir l’assentiment rationnel de tous, qui veut que la foi soit libérée. Dépassement de la logique « idéaliste », pour laquelle rien n’est qui ne soit posé par le savoir, vers une logique « réaliste », où est posée à l’autre, donnée, la position d’un Autre absolu absent, d’une vérité totale au-delà du savoir sans quoi il ne peut y avoir de savoir philosophique, l’acte de foi primordial qui est d’abord pour la philosophie la position même de l’être. Don de sa propre foi par lequel seulement elle peut libérer la foi dans le monde social. En cela la foi est grâce faite par la philosophie.
Montrons d’abord en quoi la foi doit être introduite dans le monde social. Il ne suffit pas que l’interprétation philosophique ait acquis puissance par l’institution. Il faut encore que le monde social renonce à son désir de sacrifice, c’est-à-dire d’exercice en commun d’une violence contre un seul, victime à laquelle on fait porter le poids de la finitude pour assurer l’illusion de toute-puissance du groupe. Or la finitude veut en même temps qu’on incarne en tel autre l’Autre absolu, et que le mal et la violence soient en chacun. Dès lors, ou bien on s’en tient immédiatement à l’incarnation de l’Autre absolu, en se dissimulant la contradiction ; et, les fétiches, ce qui est l’incarnation de cet Autre, étant en même temps principe du mal, la peur devient l’élément essentiel, et le tout pour l’être fin est d’arriver à détourner le mal sur d’autres, à capter pour lui quelque chose de cette puissance obscure. C’est la superstition, qui se caractérise par l’idée qu’il y a des « causes » dont dépendent les hommes, contre toute liberté (Wittgenstein dit ainsi que « la croyance au rapport de cause à effet est la superstition »). Elle conduit au sacrifice. Ou bien on s’affronte à la contradiction ; et on doit poser l’Autre absolu comme absent, au-delà de toute incarnation possible, en justifiant par lui le mal qui se maintient, et l’incarnation de l’Autre. C’est la foi, qui libère l’homme de la peur, ouvre l’espace d’une liberté absolue, d’une sublimation totale où puisse être revoulue la finitude qui vaut pour tous — disparition du sacrifice.
Comment la philosophie peut-elle dès lors introduire la foi dans le monde social ? Par l’institution elle a acquis la puissance suprême. Pour défaire les hommes de l’illusion de la toute-puissance humaine, il faut, au point même où on a atteint la plus grande puissance, effectuer ce que Blanchot appelle une « déclaration d’impuissance », reconnaître l’impossibilité, pour toute entreprise humaine, finie, même celle où se déploie le savoir le plus rigoureux, de parvenir à agir sur les hommes. Mais ce n’est pas pour la philosophie renoncer à sa visée essentielle de justice, et elle doit supposer que peut venir, qu’est déjà présente en l’autre, comme sacrée, la loi absolument juste qu’elle proclame. Reconnaissance de la toute-puissance du sacré, affirmation par la philosophie de sa foi. En cela la philosophie se distingue de toutes les formes de magie qui, elles aussi, ont une foi, par laquelle elles peuvent dépasser l’enlisement superstitieux dans la passivité. Mais la magie ne communique pas sa foi, entretient en l’homme l’illusion de « causes » liant la liberté. Ainsi bien sûr pour la sorcellerie, mais aussi dans ces formes modernes de la magie que sont la technique et la science. Là où elle communique, dans la science, ce n’est que la communication de l’information. A la philosophie au contraire revient de communiquer l’incommunicable, liberté absolue et autonomie impliquées dans la foi.
Qu’est-ce qui dans ces conditions permet que par la philosophie la foi soit communiquée ? D’abord certes le seul fait de sa réalité logique. Au-delà de la logique « idéaliste » ou formelle, c’est son principe même qui conduit la logique à reconnaître la position de l’être au-delà du savoir comme son acte fondateur, à se marquer comme caractérisée ainsi par une torsion fondamentale. Logique « réaliste » pour la pensée de l’inconscient qui, d’une part, contre la logique idéaliste reprend la conception heideggérienne de l’être au-delà de l’étant, comme Autre de l’étant, et se veut, d’autre part, logique spéculative, exposition de la consistance même de cet être. Rien ici de fidéiste, d’un quelconque renoncement au savoir, sinon au pouvoir. Et c’est précisément par cette reconnaissance de la foi que la philosophie peut apparaître à l’ensemble du monde social dans toute l’objectivité de son savoir. Car elle parvient alors à justifier pleinement tous les discours, à y voir la présence de la pensée absolue, jusqu’au discours empiriste ou hystérico-sceptique, qui pose bien comme thèse qu’il n’y a pas de vérité, mais pas de vérité simplement sur le plan du savoir, et qui trouve sa vérité par la foi. Ainsi pour l’empirisme anglo-saxon en général, et particulièrement pour l’empirisme logique contemporain qui débouche avec Kripke sur l’Autre divin comme désignation première du langage. Mais, posée dans le monde social, et pour ceux avant tout qui refusent d’entrer dans le travail de la question, la foi doit perdre le caractère abstrait qu’elle a d’abord dans la philosophie et se faire proprement foi religieuse. Et on est alors amené à se demander de quelle religion, si la philosophie avance sa visée politique contre le sacrifice, élément décisif de toute religion.
La cause de l’interprétation philosophique est la révélation. Est-ce acceptable pour la psychanalyse ? Est-ce soutenable avec la psychanalyse ? Disons simplement que c’est la psychanalyse, et elle seule, qui permet à la philosophie de penser la vérité des religions révélées, juive et chrétienne. D’une part l’essence de la religion, comme relation essentielle à un Autre absolu lieu d’une effective vérité, est impliquée par la psychanalyse, même si elle doit la taire. D’autre part la forme de la religion, en tant que loi ordonnant le monde social comme totalité, si elle est récusée d’abord par la position de l’inconscient, est supposée par la psychanalyse comme forme du moins des religions révélées, pour garantir le monde laïc hors duquel elle est impossible.
Seule la révélation peut garantir la foi. Car la religion en elle-même, comme institution humaine où l’homme détermine le sacré, a sans doute comme essence la relation à l’Autre absolu lieu de vérité pure ; mais, instituant un monde en fonction de cette vérité, elle ne peut que contredire la foi, l’absence de l’Autre, énoncer comme loi sacrée une loi injuste. La révélation est alors acte de l’Autre divin par lequel celui-ci apporte à l’homme la loi juste que ce dernier par lui-même n’aurait pu atteindre, mais aussi qu’il peut par lui-même reconstituer, dans une parfaite autonomie, une fois qu’elle lui a été révélée, par un Autre divin dont la révélation, au fond, est grâce, effacement même de soi. On doit alors souligner qu’il n’y a, de cette révélation à la raison philosophique, aucune contradiction. Si, avec l’inconscient, la conception hégélienne d’une continuité entre religion naturelle et religion révélée — ce qui perd le concept même de révélation — doit être récusée, de même pour la conception de Kierkegaard, reprise par Wittgenstein, et en général par la pensée de l’existence, d’une rupture avec la raison.
La révélation est d’abord particulière, apportée à un peuple élu — révélation juive. Car il faut que la loi puisse être reçue dans sa lettre, qui d’abord sauve. Si la grâce avait été d’emblée posée comme telle, si elle n’avait pas été dans un premier temps particulière, l’autonomie qu’elle déploie aurait rendu incertaine la détermination de la loi juste. La défense par Lévinas de la lettre juive contre l’intériorité chrétienne prend ici toute sa portée. Loi juste contre le sacrifice, elle requiert alors de chacun qu’il se sente infiniment responsable de l’autre, comme le dit Lévinas, qu’il se mette à la place de toute victime, renonce à sa propre condition pour l’« in-condition d’otage ». Au-delà de l’hétéronomie apparente, et par la grâce qu’elle implique, elle libère d’autre part pour l’autonomie pure de l’interprétation. Mais, comme révélation particulière qui ne se communique pas et renvoie à une grâce que Dieu seul peut donner, elle conduit les autres nations à l’envie et à la haine et voue son peuple à la menace de la persécution.
La révélation est enfin universelle. Révélation du caractère toujours sacrificiel du rapport de l’homme à la loi religieuse, même absolument juste ; de la nécessité de la grâce pour libérer l’homme du sacrifice, qui est le péché — Bataille l’avait déjà noté. Révélation chrétienne, où la grâce est posée comme telle, au-delà de la loi, mais sans la dénier, plutôt comme sa cause (« La grâce n’a pas détruit la loi, mais la fait exercer », dit Pascal). C’est alors l’acte même de l’Incarnation, de la Passion et de la Résurrection qui est révélation, qui, grâce suprême, veut restituer la grâce perdue d’Adam, fait apparaître le fond du sacrifice comme haine de Dieu. Mais la christianisation du monde social est lente, justifiant ce que Lévinas appelle l’« insuccès du christianisme sur le plan social et politique », conduisant finalement à l’horreur de l’Holocauste comme répétition du sacrifice du Christ, à partir de quoi le christianisme comme réalité sociale devient conforme à son essence. Place est alors garantie socialement à ce phénomène inouï qu’est la psychanalyse, et dont la supposition première est celle-ci : les hommes ont reçu la grâce, le seul problème est de la communiquer.